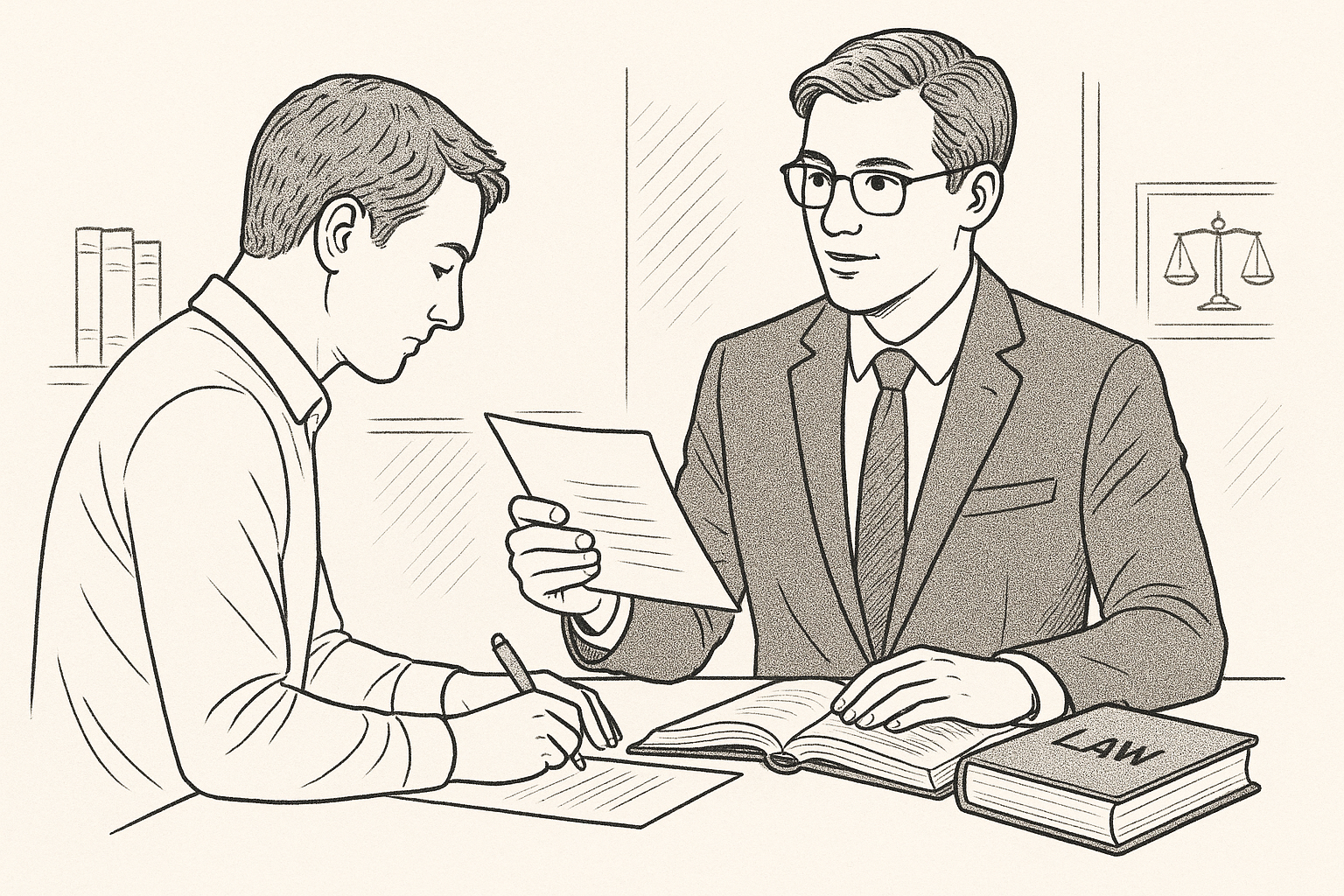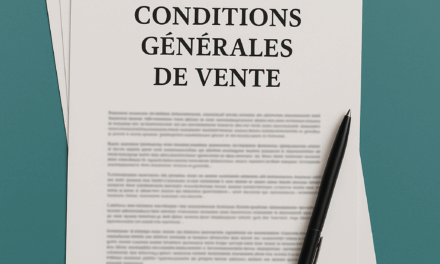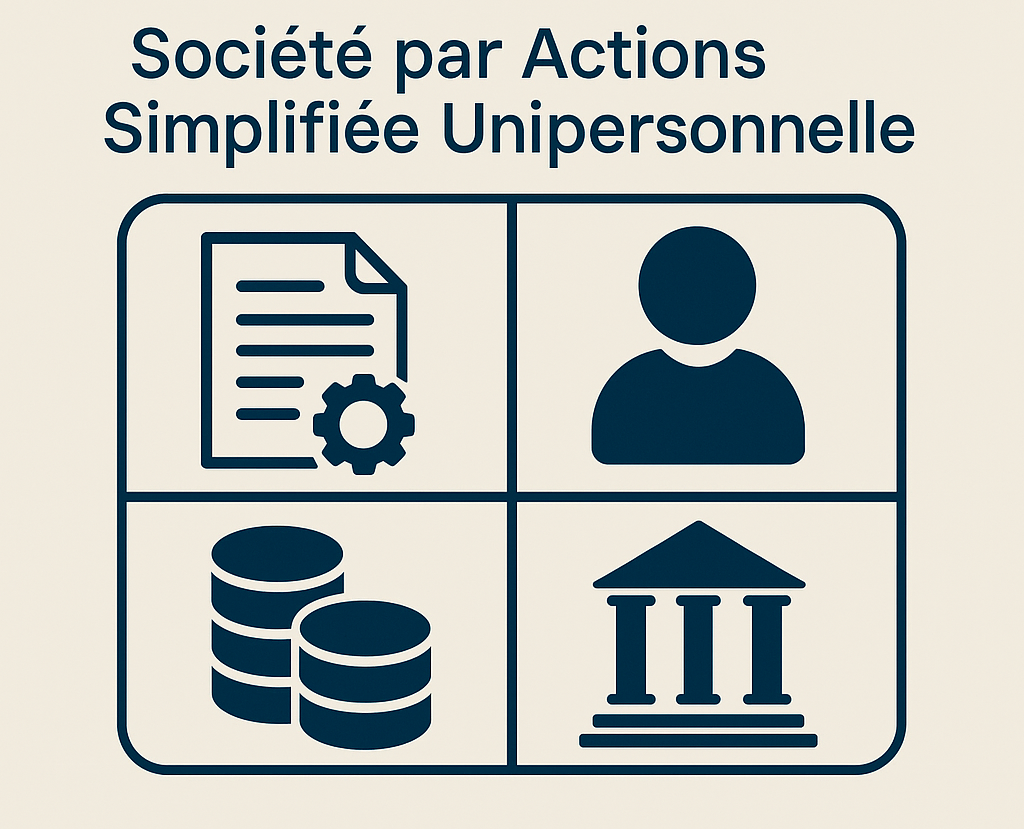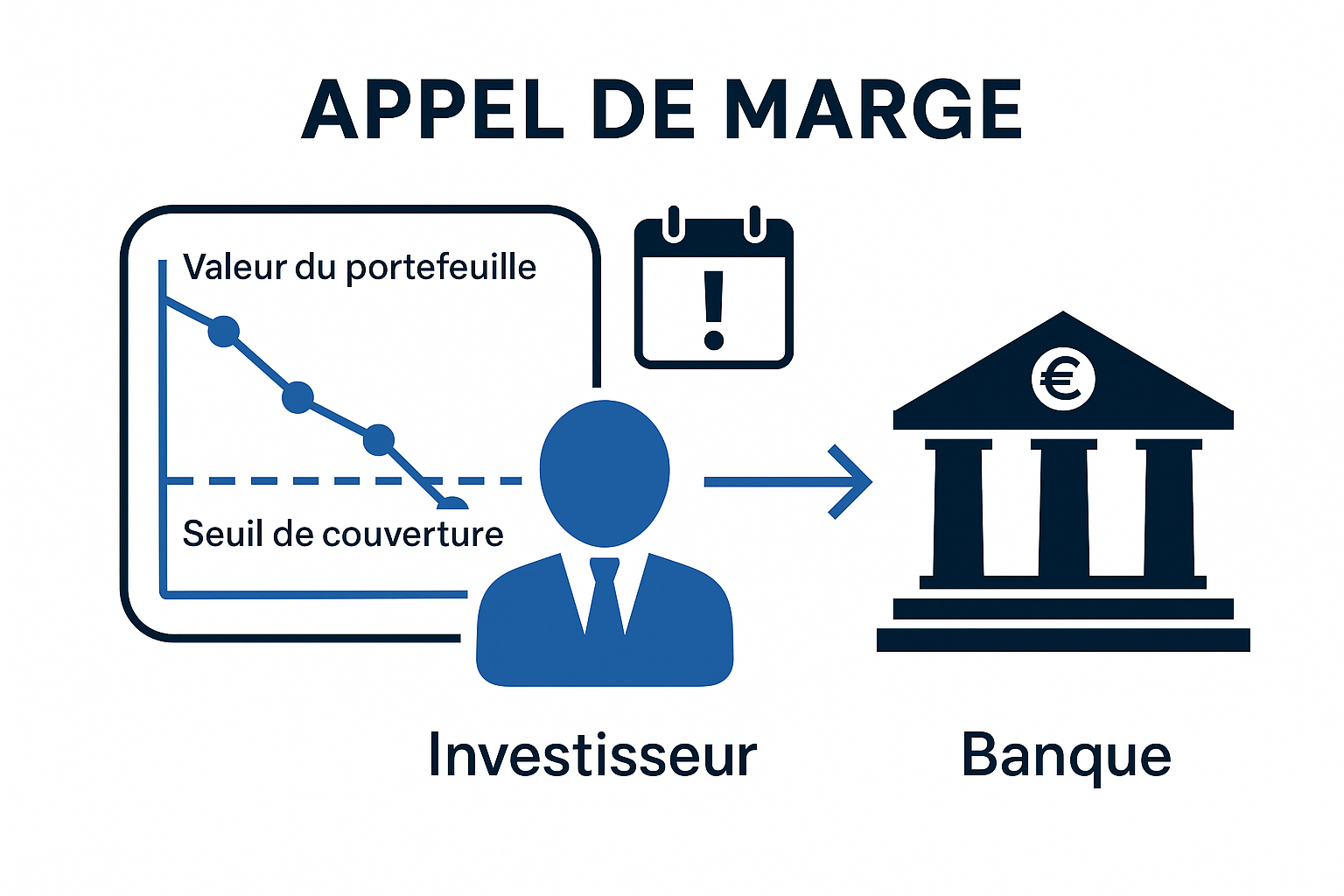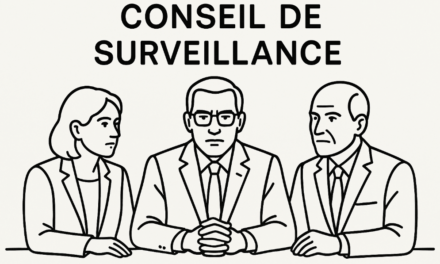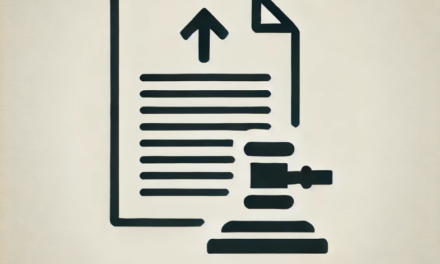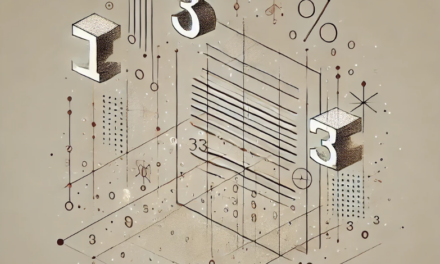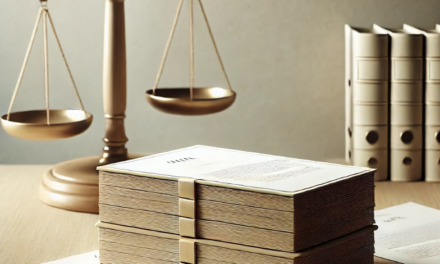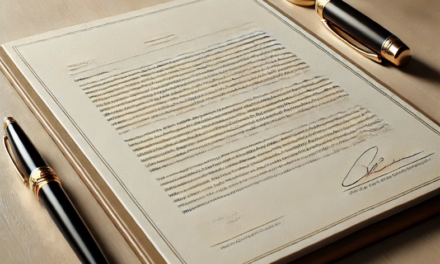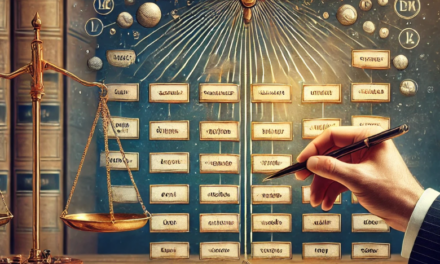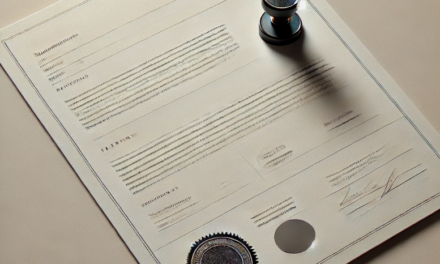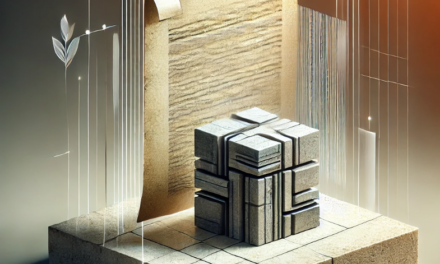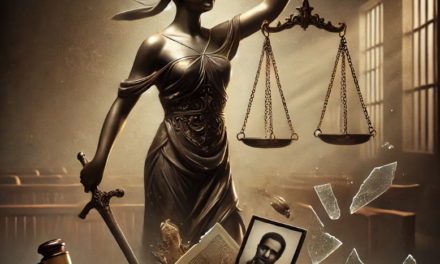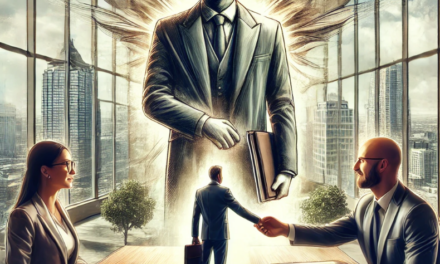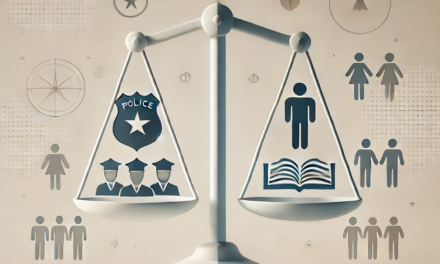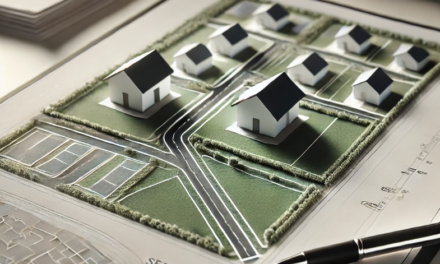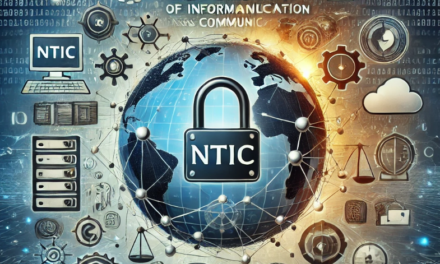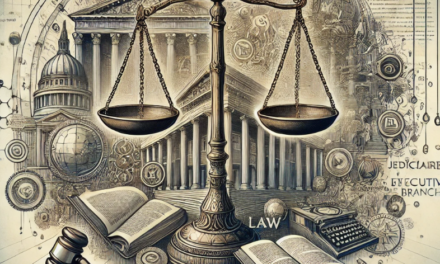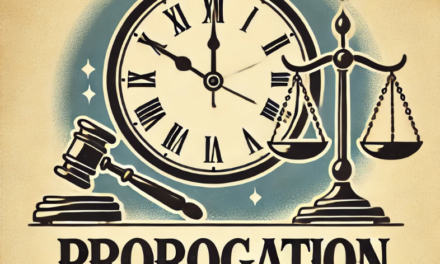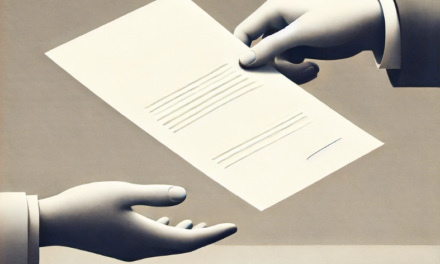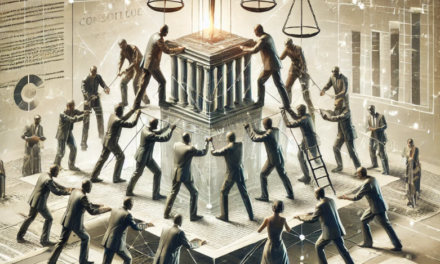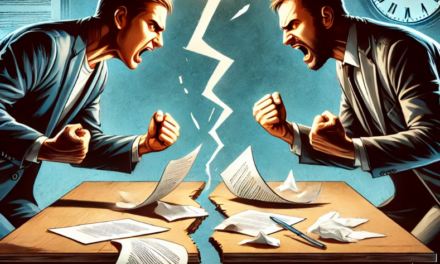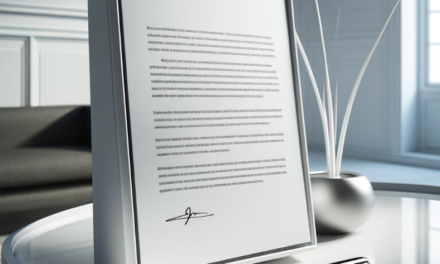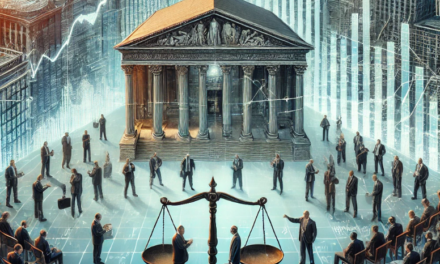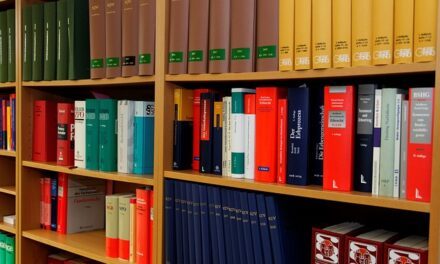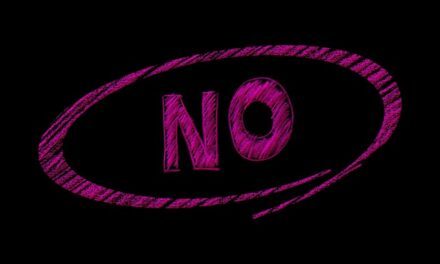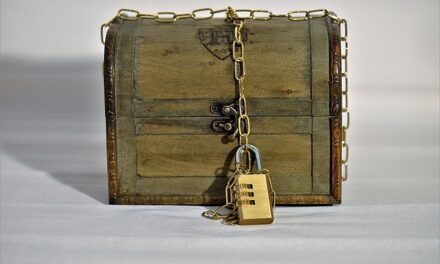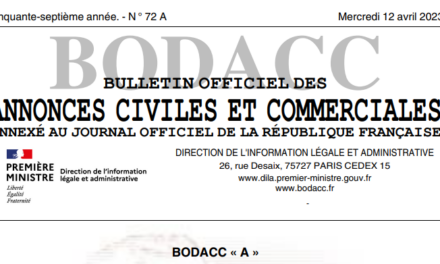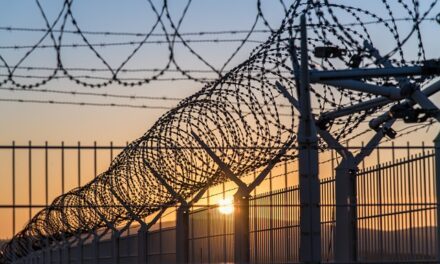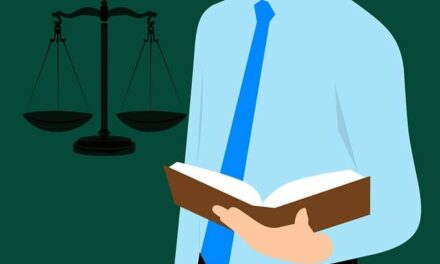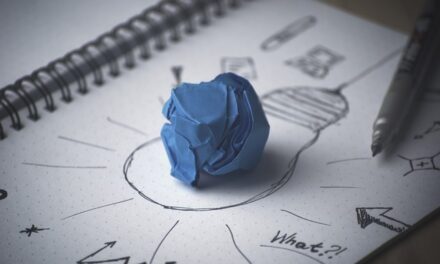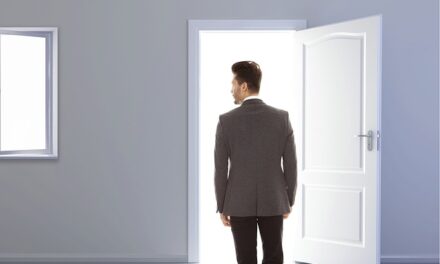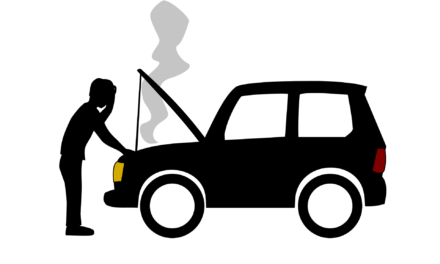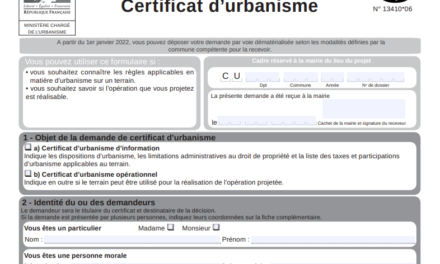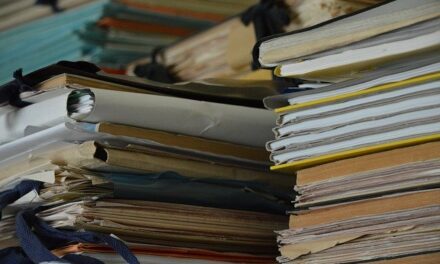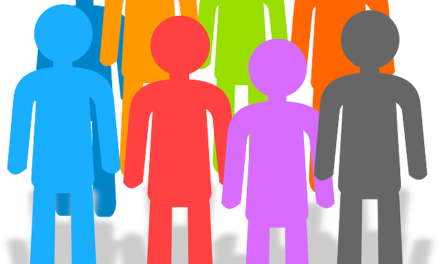Définition : aliments
En droit, la notion d’aliments désigne les prestations destinées à permettre à une personne de satisfaire ses besoins essentiels (nourriture, logement, soins, etc.) lorsqu’elle ne peut y subvenir seule. Cette obligation vise à garantir la solidarité familiale et peut revêtir une importance particulière dans des litiges familiaux.
Fondements juridiques de l’obligation alimentaire
Une obligation issue du droit civil
L’obligation alimentaire découle principalement du Code civil aux articles 205 à 211. Elle impose aux membres d’une même famille de s’aider mutuellement en cas de besoin.
- Article 205 : les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
- Article 206 : les gendres et belles-filles doivent également des aliments à leurs beaux-parents, sous certaines conditions.
- Article 207 : l’obligation alimentaire est réciproque, et peut aussi concerner les parents envers les enfants.
Une obligation d’ordre public
Il ne peut être dérogé à cette obligation par une clause contractuelle ou un accord familial. Elle est considérée comme une obligation légale impérative, à laquelle aucune renonciation n’est possible si le besoin est avéré.
Les bénéficiaires de l’obligation alimentaire
Les ascendants et descendants
Le principe fondamental de l’obligation alimentaire repose sur le lien de filiation.
-
Les enfants doivent des aliments à leurs parents et autres ascendants dans le besoin (art. 205 C. civ.).
-
Réciproquement, les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants majeurs qui ne peuvent pas assurer leur subsistance par eux-mêmes (art. 207 C. civ.).
-
Cette obligation joue en cascade : un petit-enfant peut être appelé à contribuer si son parent, débiteur principal, est dans l’impossibilité de remplir son obligation.
La jurisprudence insiste sur le fait que l’obligation alimentaire vise à garantir la subsistance minimale (nourriture, logement, santé) et non à maintenir un train de vie confortable. Le juge vérifie toujours la réalité du besoin du créancier et les capacités financières du débiteur.
Le conjoint et l’ex-conjoint
Entre époux, l’article 212 du Code civil impose le devoir de secours.
-
Pendant le mariage, il peut donner lieu à une pension alimentaire versée par l’un des époux lorsque l’autre se trouve dans le besoin.
-
En cas de divorce en cours, le juge aux affaires familiales peut ordonner le versement d’une pension alimentaire à titre provisoire (art. 255 C. civ.), jusqu’au prononcé du divorce définitif.
Après le divorce, l’obligation alimentaire entre ex-époux disparaît :
-
elle est remplacée par la prestation compensatoire (art. 270 et s. C. civ.), qui vise à compenser la disparité créée par la rupture ;
-
une pension alimentaire post-divorce n’est due qu’au profit des enfants communs (art. 371-2 C. civ.), et non pour l’ex-conjoint lui-même.
Les alliés : gendres et belles-filles
L’article 206 du Code civil prévoit une obligation alimentaire originale :
-
les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beaux-parents, et réciproquement, lorsque ceux-ci sont dans le besoin ;
-
cette obligation disparaît si le conjoint (lien qui créait l’alliance) et les enfants issus de ce mariage sont décédés (art. 207 al. 2 C. civ.).
Les collatéraux ?
Le Code civil ne prévoit pas d’obligation alimentaire entre frères et sœurs. La solidarité familiale reste limitée aux lignes directe ascendante et descendante, et aux alliés par mariage (gendres et belles-filles).
Toutefois, les juges peuvent, dans certaines hypothèses exceptionnelles (par exemple via la solidarité entre cohéritiers ou dans le cadre d’un engagement contractuel volontaire), imposer une forme de participation financière. Mais en principe, les collatéraux (frères, sœurs, oncles, tantes, cousins) n’entrent pas dans le champ de l’obligation alimentaire légale.
Détermination et mise en œuvre de l’obligation alimentaire
Le montant de l’obligation alimentaire est fixé selon deux critères essentiels :
les besoins du créancier : il s’agit des dépenses nécessaires à une subsistance digne (nourriture, logement, santé, éducation pour un enfant majeur non autonome). Le juge ne retient pas le confort ou le superflu, mais seulement les besoins essentiels ;
les ressources du débiteur : le juge évalue les revenus, le patrimoine, les charges (loyers, emprunts, entretien d’autres enfants).
Il n’existe pas de barème obligatoire en droit civil. En revanche, en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants après divorce ou séparation, un barème indicatif a été publié par le ministère de la Justice (utilisé par les JAF comme repère).
Le juge peut ordonner une expertise financière (examen de patrimoine, enquête sociale) pour apprécier avec précision la capacité contributive du débiteur.
Procédure judiciaire
Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord amiable, le juge aux affaires familiales (JAF) est compétent. L’action peut être introduite par requête ou assignation.
Le JAF examine les éléments produits par les deux parties (déclarations fiscales, fiches de paie, attestations, justificatifs de charges). Il rend ensuite une décision qui peut :
-
fixer une pension alimentaire versée sous forme de somme d’argent (mensuelle en pratique) ;
-
prévoir, exceptionnellement, une exécution en nature (mise à disposition d’un logement, paiement direct de certaines dépenses comme frais médicaux ou scolaires) ;
-
ordonner des modalités spécifiques de paiement, par exemple un paiement direct par l’employeur ou la saisie sur salaire, en cas de risques d’impayés.
Révision ou suppression des aliments
L’obligation alimentaire n’est pas figée : elle peut évoluer selon les situations.
-
En cas de modification substantielle des ressources du débiteur (perte d’emploi, baisse de revenus, retraite) ou des besoins du créancier (autonomie acquise, amélioration de situation), la pension peut être révisée à la hausse ou à la baisse.
-
Elle peut être supprimée si le créancier n’est plus dans le besoin (emploi stable, remariage dans le cas d’un conjoint) ou si le lien juridique disparaît (ex. divorce mettant fin au devoir de secours).
La demande de révision doit être faite devant le JAF, qui statue à nouveau en tenant compte des nouvelles circonstances.
En cas de non-paiement, le créancier dispose de procédures spécifiques de recouvrement (paiement direct, saisie, Trésor public, etc.), et le défaut volontaire peut constituer le délit d’abandon de famille (art. 227-3 C. pén.).
Recouvrement des pensions alimentaires
Le non-paiement d’une pension alimentaire est fréquent et peut avoir des conséquences lourdes pour le créancier comme pour le débiteur. Le droit français met à disposition plusieurs mécanismes spécifiques de recouvrement :
Le paiement direct (loi du 2 janvier 1973, art. L. 213-1 et s. du Code des procédures civiles d’exécution)
Le créancier peut demander à ce que la pension soit directement prélevée par l’employeur, la banque ou tout tiers débiteur du débiteur d’aliments.
Ce mécanisme est rapide et efficace : il peut porter sur les pensions à échoir ainsi que sur les arriérés des 6 derniers mois.
La saisie sur salaire ou saisie attribution
Le créancier peut obtenir une décision du juge permettant de prélever directement sur les rémunérations ou sur les comptes bancaires du débiteur.
Elle est possible même sans paiement direct, mais nécessite une procédure judiciaire.
L’intervention de l’ARIPA (Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires)
Depuis 2017, l’ARIPA (rattachée à la CAF) peut se substituer au créancier pour percevoir la pension impayée.
Elle garantit le versement d’un minimum forfaitaire (l’ASF, allocation de soutien familial) et se charge de recouvrer les sommes auprès du débiteur.
Elle peut également mettre en place une intermédiation financière obligatoire pour éviter les contacts directs entre parents séparés.
Le recours au Trésor public
Le créancier peut demander au procureur de la République le recouvrement par le comptable public.
Cette procédure, dite recouvrement public des pensions alimentaires, permet de mobiliser les services fiscaux pour contraindre le débiteur au paiement.
Les sanctions pénales
Le non-paiement volontaire pendant plus de deux mois constitue le délit d’abandon de famille (art. 227-3 C. pén.), passible de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
Des sanctions civiles peuvent également être prononcées (dommages-intérêts, condamnation aux dépens).
Conclusion :
L’obligation alimentaire illustre l’importance de la solidarité familiale en droit français. Elle garantit que toute personne dans le besoin puisse obtenir le soutien minimal nécessaire à sa subsistance de la part de ses proches parents ou alliés. Encadrée par le Code civil et d’ordre public, elle s’impose aux ascendants, descendants et, dans certains cas, aux alliés, sans possibilité de renonciation.
La mise en œuvre de cette obligation repose sur un équilibre entre les besoins du créancier et les capacités financières du débiteur. Son exécution est contrôlée par le juge aux affaires familiales, qui peut fixer, réviser ou supprimer la pension, et qui dispose de nombreux outils de recouvrement en cas d’impayés.
Au-delà de sa dimension privée, cette institution a également une portée sociale et pénale : le défaut de paiement expose le débiteur à des sanctions civiles et à la répression de l’abandon de famille.
Ainsi, les « aliments » dépassent la simple aide matérielle : ils constituent un mécanisme juridique fondamental de protection et de cohésion, garantissant à chacun la possibilité de vivre dignement grâce à la solidarité familiale instituée par la loi.
Vous êtes dirigeant de TPE ou PME ? Profitez de notre abonnement juridique et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé tout au long de l’année.