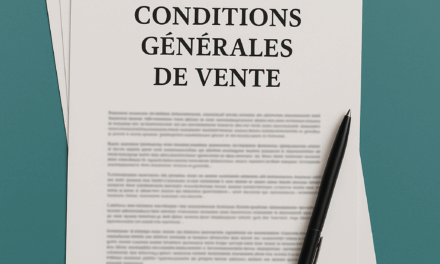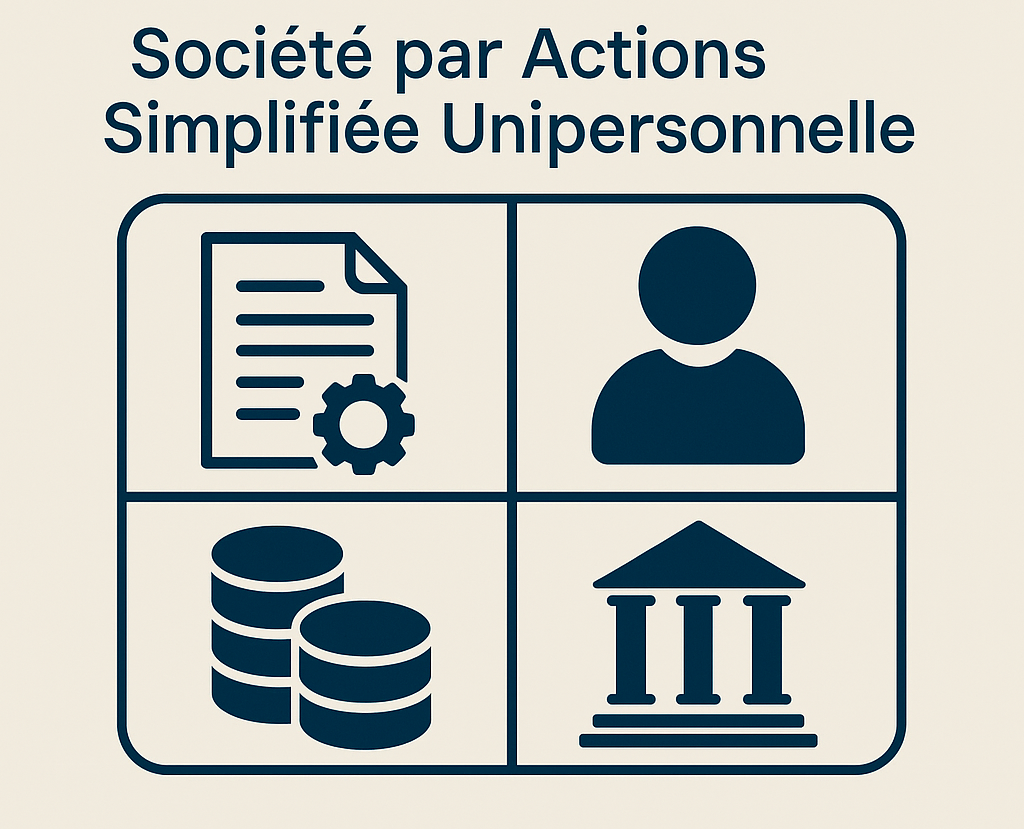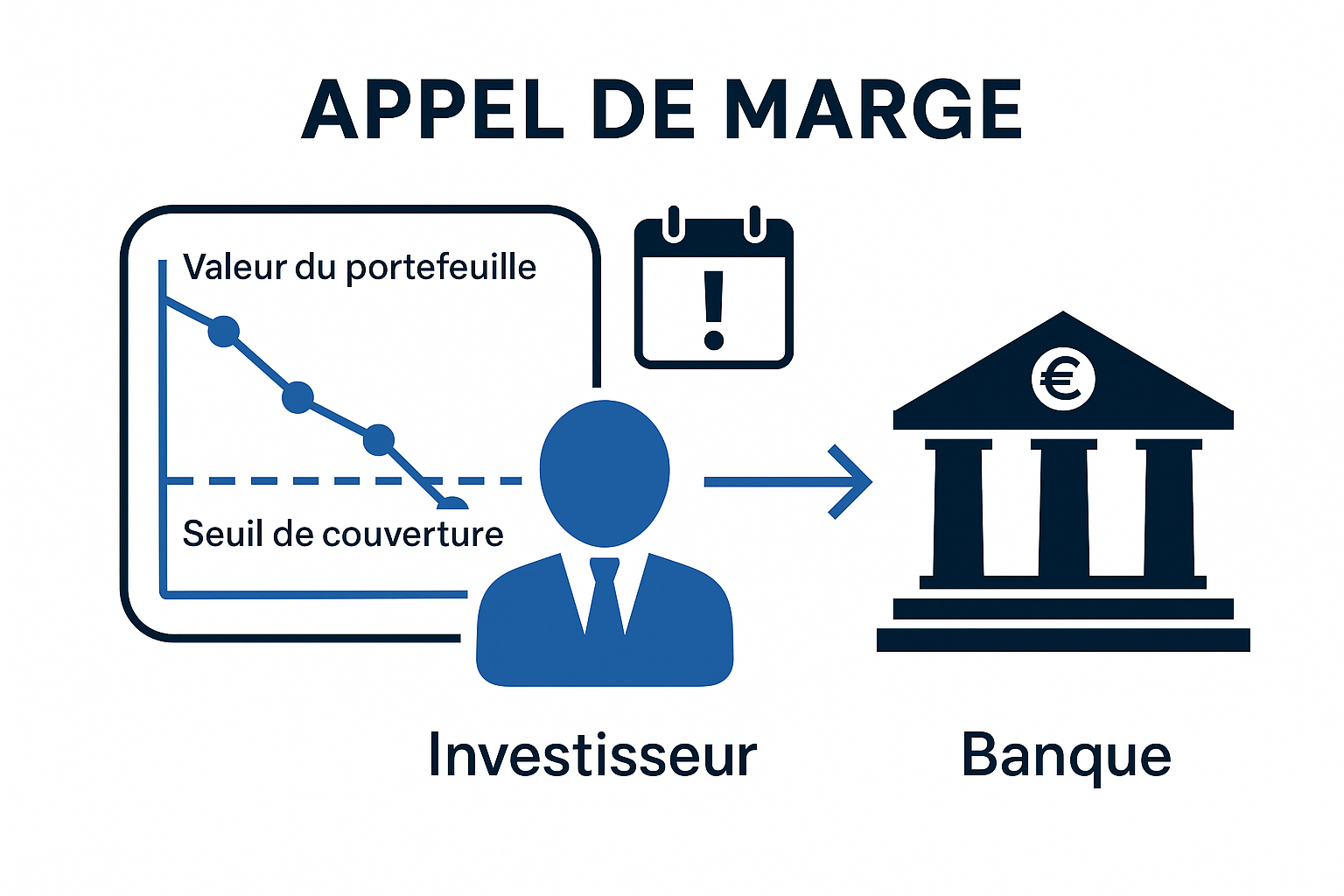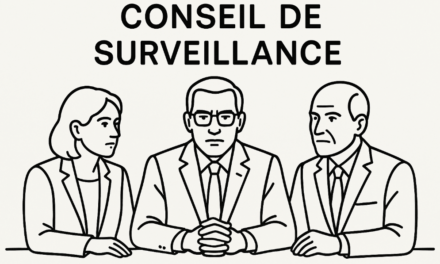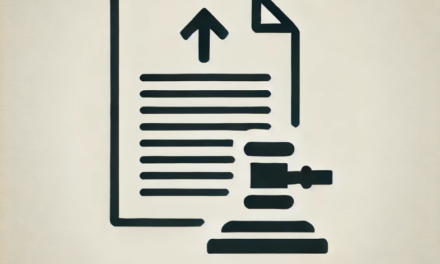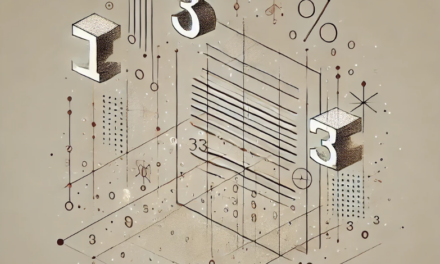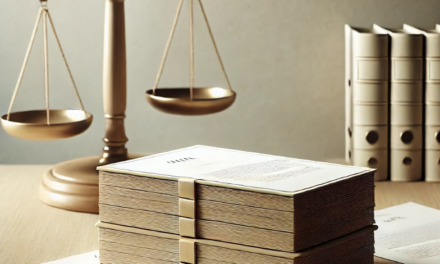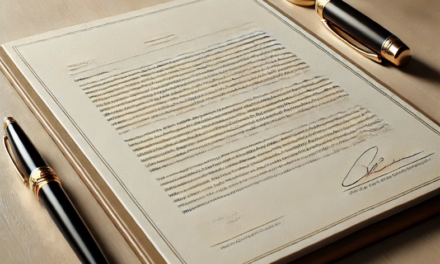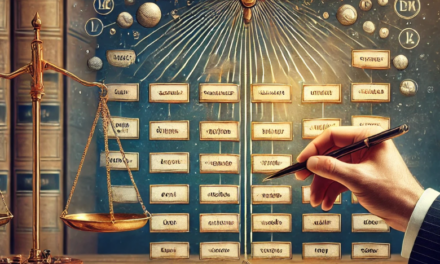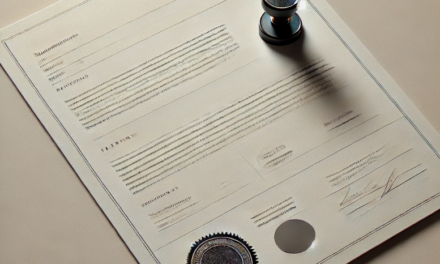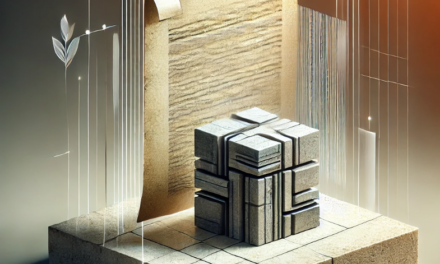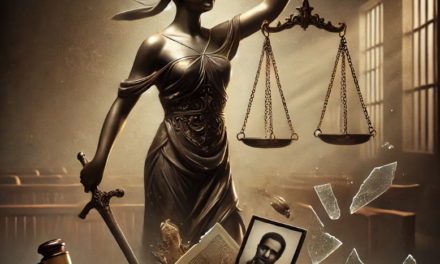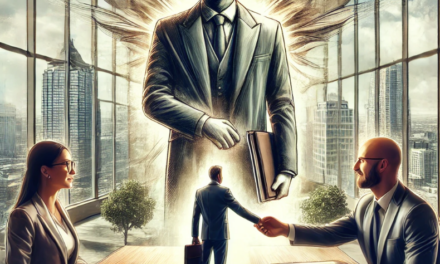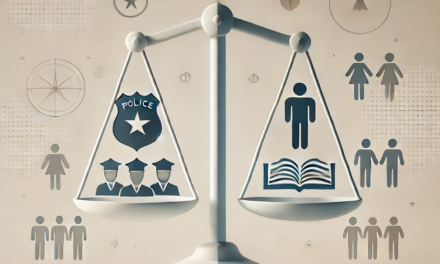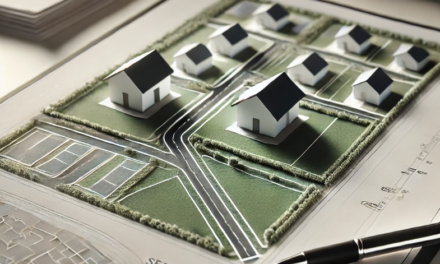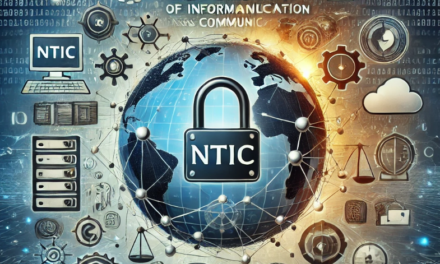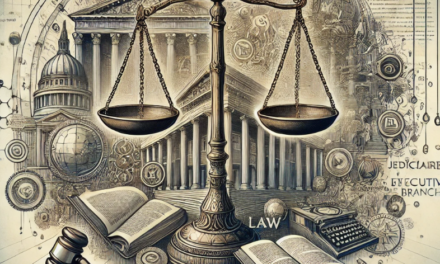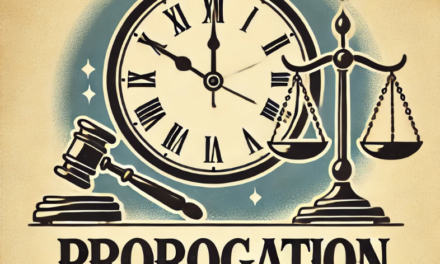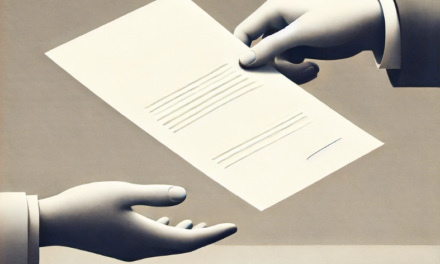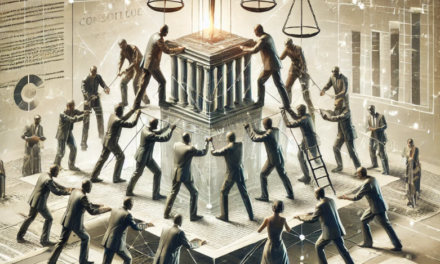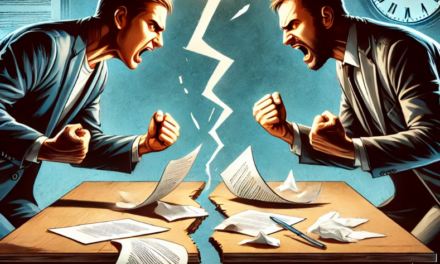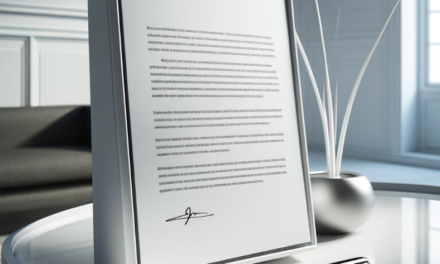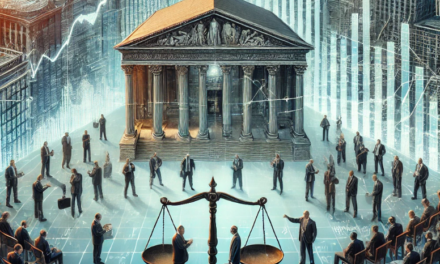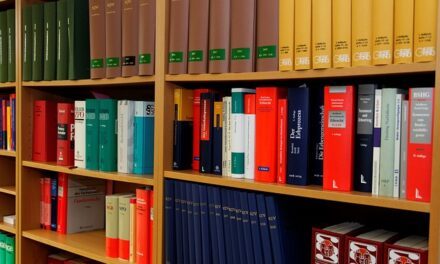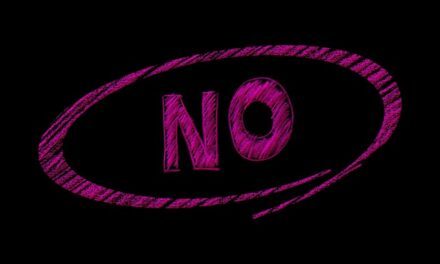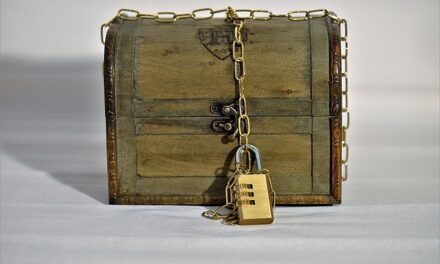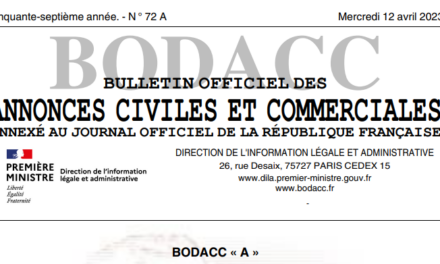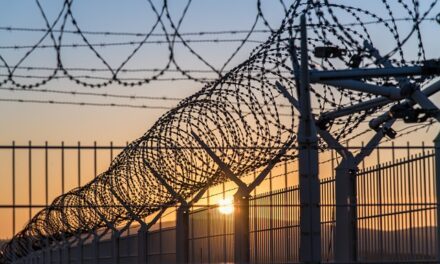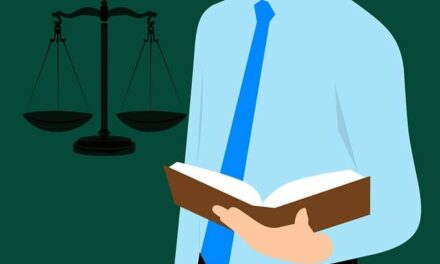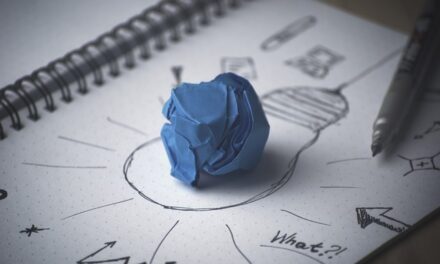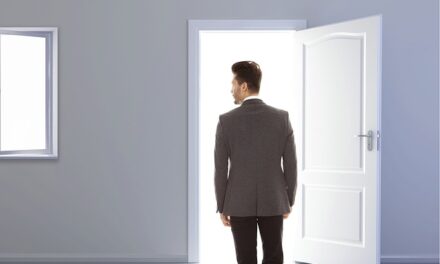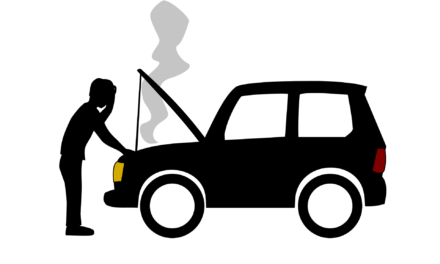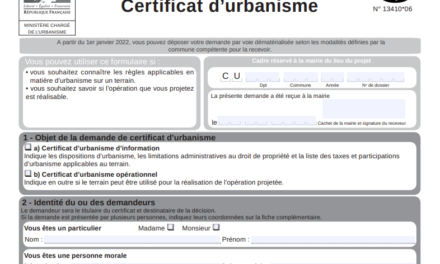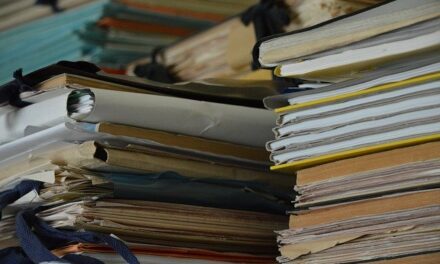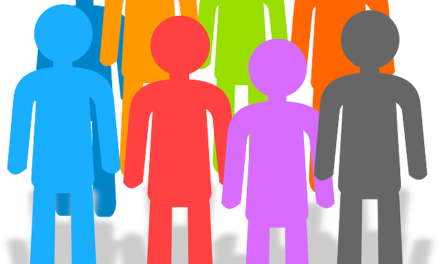La notion de requérant est un terme juridique que l’on retrouve en procédure judiciaire. Le requérant est la personne qui saisit une juridiction ou une autorité administrative par le biais d’une requête en vue de faire valoir ses droits ou d’obtenir une décision. Son statut et ses droits varient en fonction de la matière concernée et des règles de procédure applicables.
Définition
Le requérant désigne toute personne (physique ou morale) qui introduit une requête devant une juridiction ou une administration dans le but de faire valoir un droit ou contester une décision.
Contrairement au demandeur en procédure civile, qui agit dans le cadre d’une assignation, le requérant introduit une requête écrite directement devant l’autorité compétente. Ce mode de saisine est souvent utilisé dans les juridictions administratives et dans certaines procédures civiles spécifiques.
Quoi qu’il en soit, dans le cas où la requête aura pour objet d’introduire une action en justice, le requérant devient demandeur, de sorte que les deux termes se confondent et peuvent être utilisés indifféremment.
Fondements juridiques
Le statut du requérant repose sur plusieurs bases légales, en fonction de la juridiction saisie :
En droit civil et commercial, les articles 54 et 57 du Code de procédure civile régissent la requête en matière civile, notamment pour les procédures non contradictoires.
En droit administratif, l’article R. 411-1 du Code de justice administrative précise que toute personne qui introduit une demande devant une juridiction administrative est considérée comme un requérant.
Enfin, en droit pénal, le requérant peut être une victime déposant une plainte avec constitution de partie civile (articles 85 et suivants du Code de procédure pénale).
Application des différents types de procédure
En Droit civil
Dans certaines procédures civiles, la demande peut être introduite par requête, notamment en matière de :
- Requête aux fins de divorce par consentement mutuel (article 229-1 du Code civil).
- Saisine du juge des tutelles pour la protection d’un majeur ou d’un mineur (article 415 du Code civil).
- Procédure de changement de prénom ou de nom devant le tribunal judiciaire (Article 60 du Code civil).
- Demandes d’injonction de payer (Article 1405 et suivants du CPC) : Pour obtenir une condamnation au paiement d’une somme d’argent sans débat préalable.
- Requêtes aux fins d’expulsion en matière locative, dans certains cas prévus par la loi.
- Demande d’homologation d’un accord (par exemple, en matière familiale pour un accord entre époux).
La requête est déposée directement au greffe du tribunal judiciaire.
Elle doit contenir les mentions obligatoires (articles 54 et 57 du CPC).Elle est examinée sans débat contradictoire par le juge. Le juge peut accorder ou refuser la demande, voire exiger une audience.
Le requérant agit généralement sans contradicteur direct, ce qui signifie que le juge peut statuer sur la demande sans confrontation entre les parties. Si le cas ne relève pas de l’un de ces domaines, la demande doit être introduite par assignation, qui est la procédure contradictoire habituelle.
En Droit administratif
En contentieux administratif, le requérant est la personne qui introduit un recours contre une décision administrative. Il existe plusieurs types de requêtes :
- Recours pour excès de pouvoir : demande l’annulation d’une décision administrative jugée illégale.
- Recours en indemnisation : demande réparation d’un préjudice causé par une autorité publique.
- Recours en référé : requête en urgence pour obtenir une suspension ou une mesure provisoire (ex. référé-liberté, référé-suspension).
Le Conseil d’État et les tribunaux administratifs examinent ces requêtes selon des règles spécifiques de procédure.
En Droit Pénal
En matière pénale, le requérant est souvent la victime d’une infraction qui cherche à obtenir justice. Il peut intervenir de différentes manières :
- Dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile (article 85 du Code de procédure pénale) pour déclencher une instruction judiciaire.
- Saisine du juge d’instruction par requête, lorsqu’une enquête est demandée sur une infraction spécifique.
- Requête en relèvement d’interdiction pour demander la levée d’une interdiction judiciaire (ex. interdiction de séjour, interdiction bancaire).
Dans ce contexte, le requérant joue un rôle actif dans le déclenchement de la procédure judiciaire.
Droits et obligations
Le requérant bénéficie d’un droit d’accès au juge, garantie constitutionnelle et conventionnelle (article 6 §1 de la CEDH). Sa demande ne pourra être appréciée que s’il respecte les conditions procédurales, à savoir :
Obligation de motivation : sa requête doit être clairement rédigée et contenir les arguments de droit et de fait. Il devra également respecter des délais, le requérant doit agir dans les délais impartis par la loi sous peine d’irrecevabilité (ex. deux mois en contentieux administratif). Enfin, il peut être contraint au paiement de frais (ex : tribunal de commerce, injonction de payer), ou encore paiement d’un timbre fiscal (dans certaines procédures, comme devant le Conseil d’État).
Effets et conséquences
L’introduction d’une requête déclenche la procédure judiciaire ou administrative. Selon la nature de la requête, le juge peut :
- Statuer immédiatement (ex. requêtes en référé en urgence).
- Engager une phase d’instruction pour analyser les éléments apportés par le requérant et les parties adverses.
- Rejeter la requête si elle est manifestement infondée ou irrecevable.
L’introduction d’une requête peut également entraîner un rejet pour irrecevabilité, si les conditions de forme ou de délai ne sont pas respectées ou encore si celle-ci n’est pas suffisemment fondée. Si celle-ci conduit à un procès, le requérant peut être condamné au frais de justice ou encore de manière plus rare, être jugé abusive et entrainé une condamnation pécunaire, en cas de recours dilatoire ou manifestement infondé (articles 32-1 du Code de procédure civile et R. 741-12 du Code de justice administrative).
Conclusion
Le requérant est un justiciable qui initie une procédure en saisissant une juridiction ou une administration par le biais d’une requête. En fonction du type de procédure engagée, le requérant doit respecter un cadre juridique strict, notamment en matière de délais et de motivation des demandes. Bien que bénéficiant du droit d’accès au juge, le requérant doit aussi se conformer aux exigences de bonne foi et de sérieux, sous peine de sanctions procédurales.
Ainsi, que ce soit pour un recours administratif, une action judiciaire civile ou une plainte pénale, la qualité de requérant impose des obligations formelles et substantielles dont le non-respect peut entraîner des conséquences procédurales.