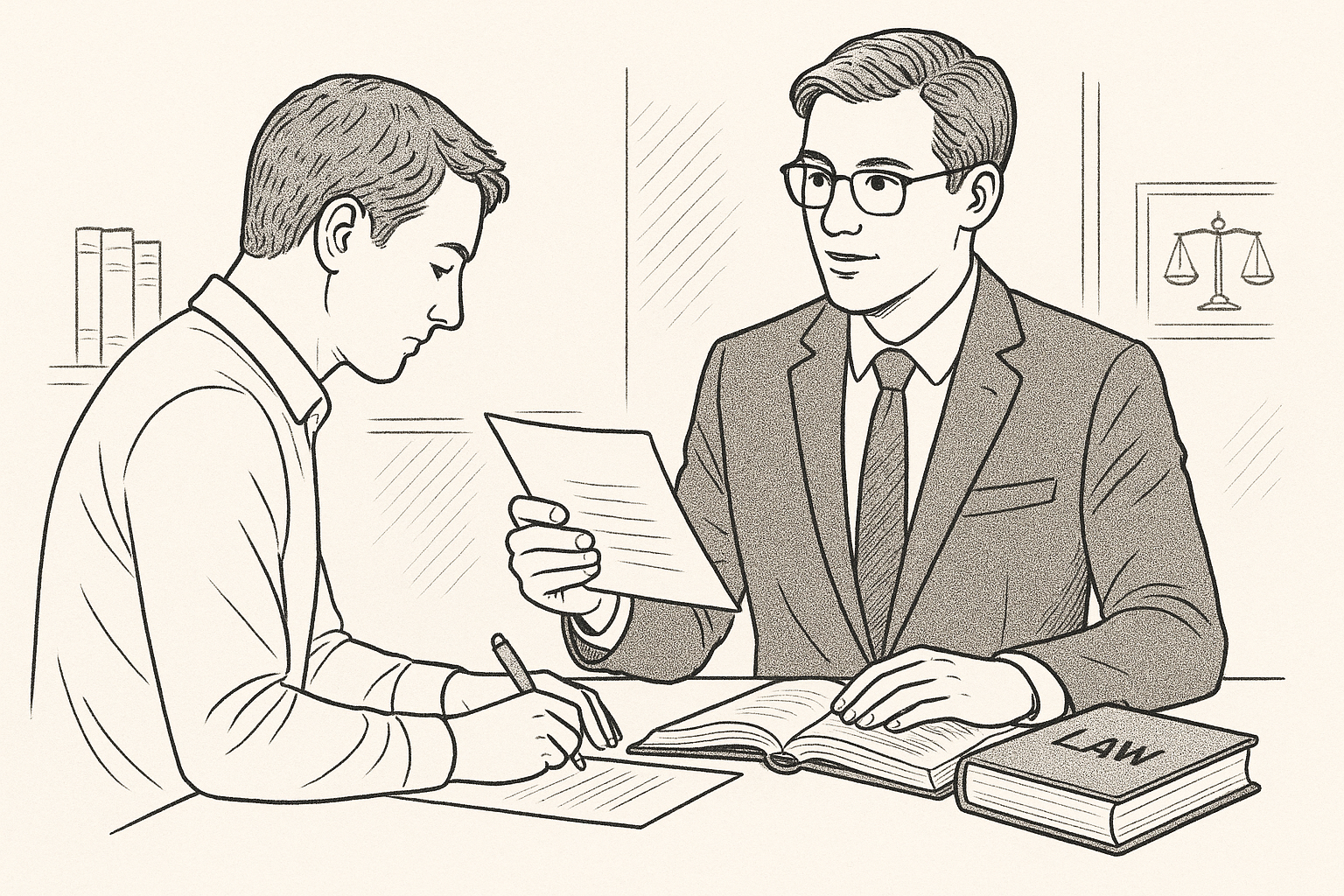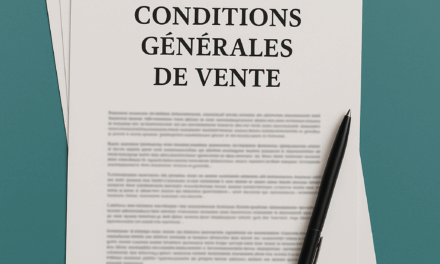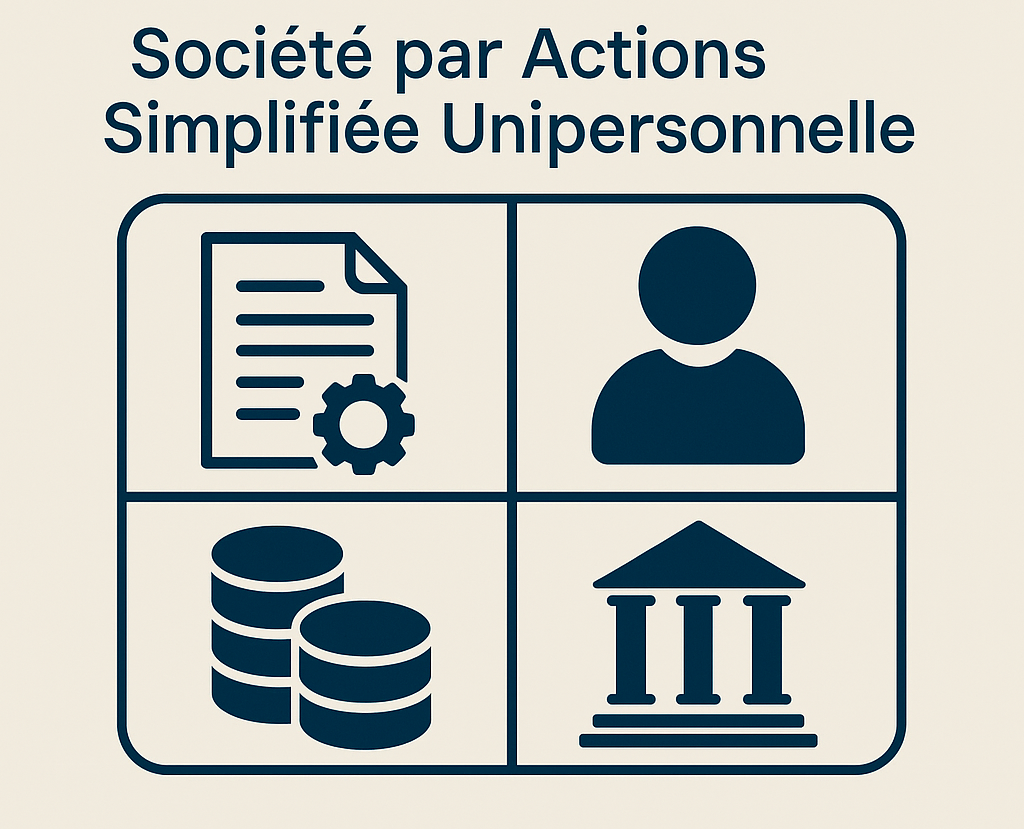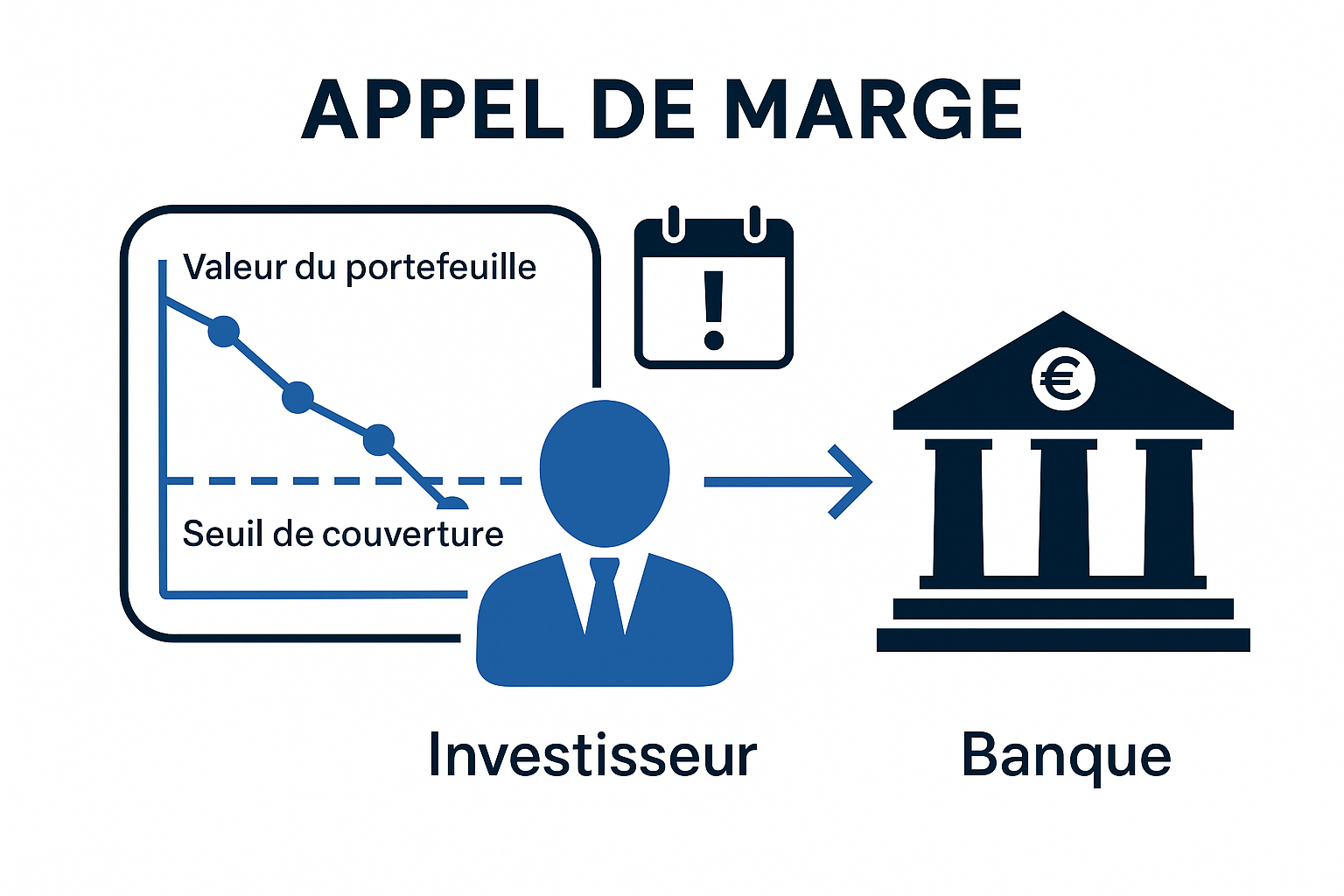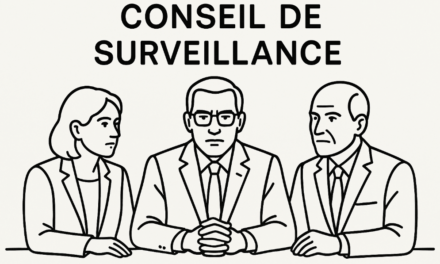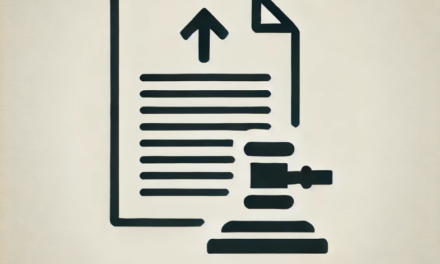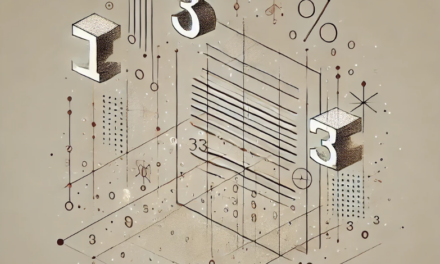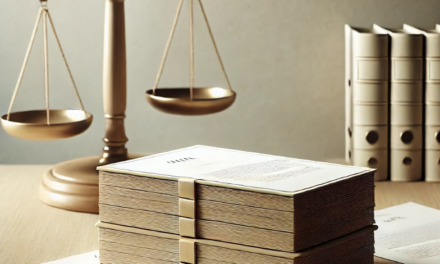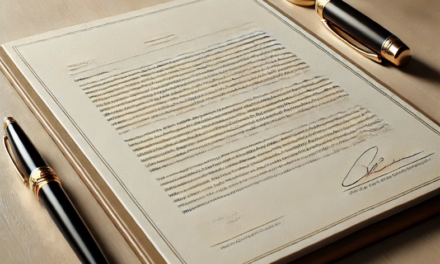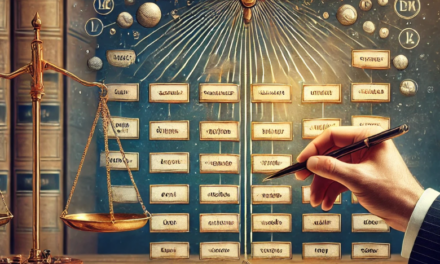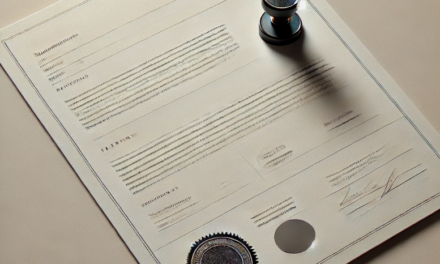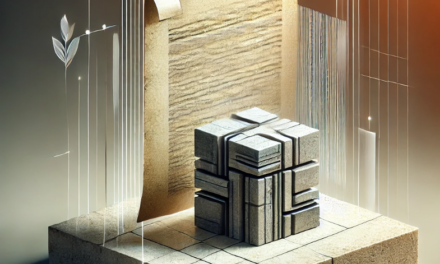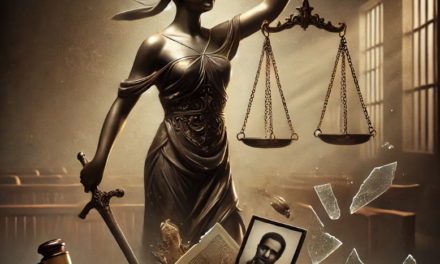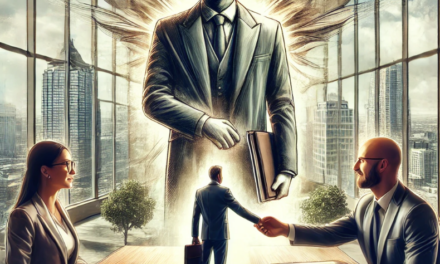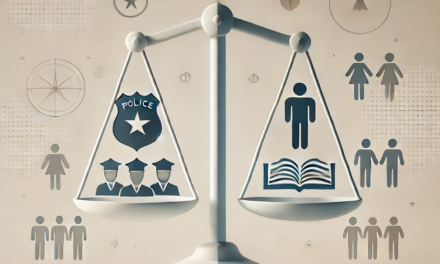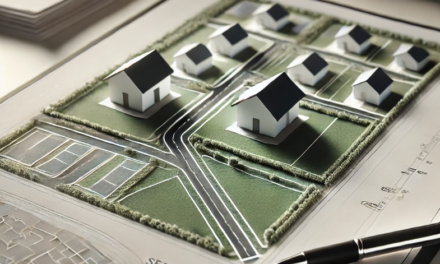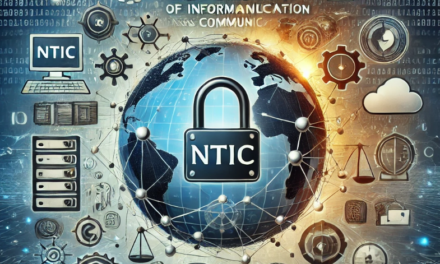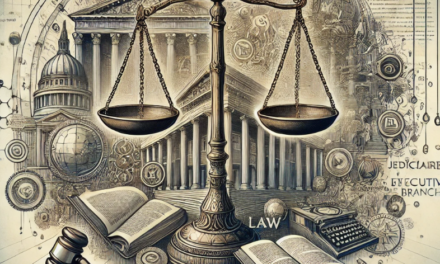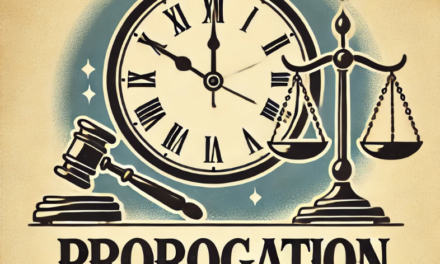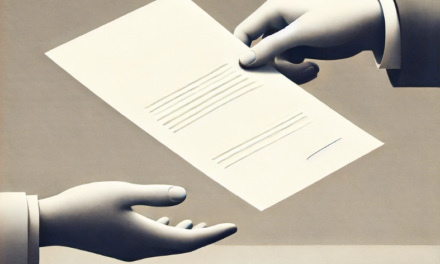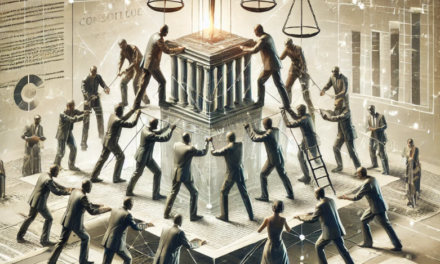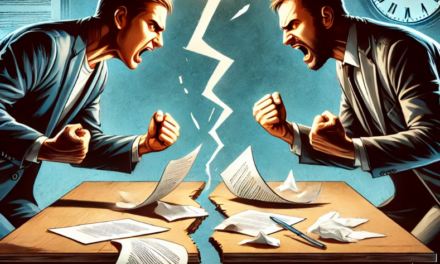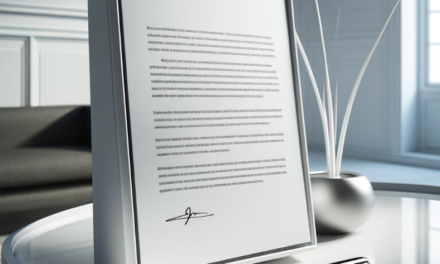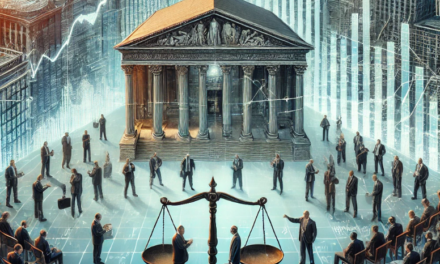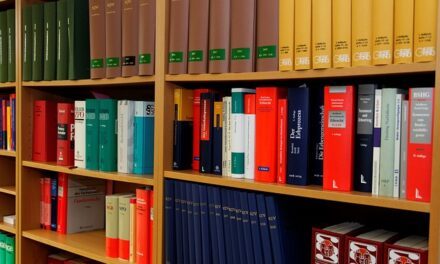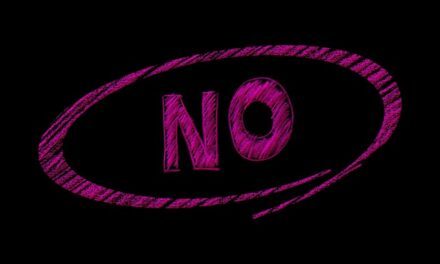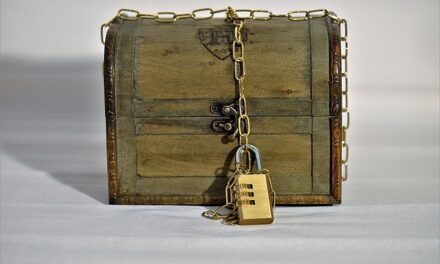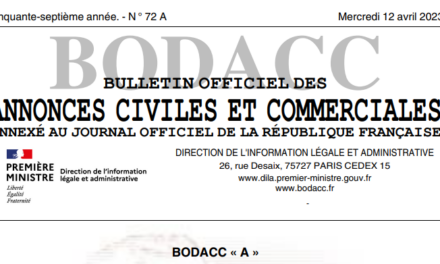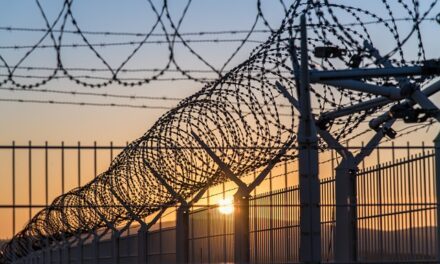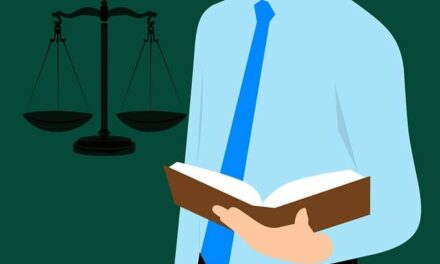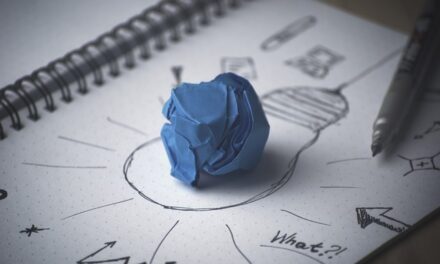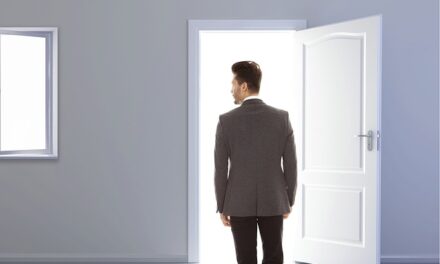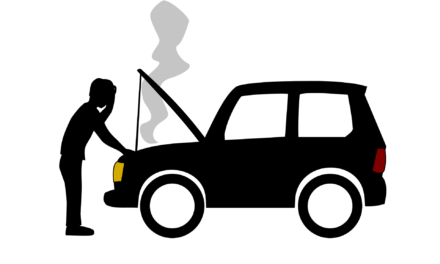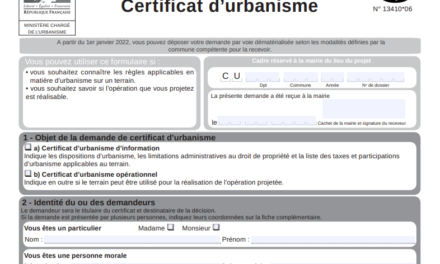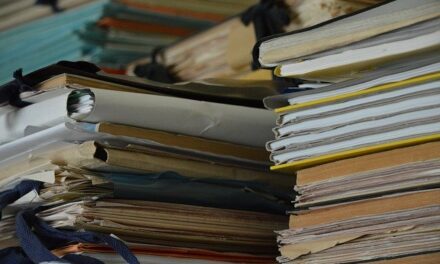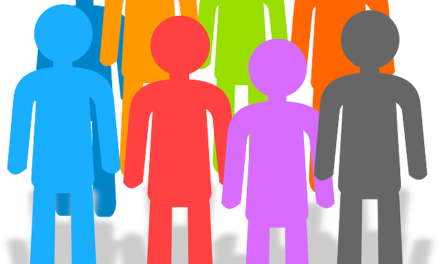Définition : allégation
En droit, une allégation désigne l’affirmation d’un fait par une partie dans un procès, un acte juridique ou une dénonciation. Elle constitue une déclaration, écrite ou orale, qui oriente le débat judiciaire et fonde les prétentions des parties.
En droit civil et social, elle doit être corroborée par des preuves (art. 9 CPC, art. 1353 C. civ.), faute de quoi elle reste dépourvue de force probante.
En droit pénal, l’allégation est au cœur de l’action publique : les faits allégués par une victime ou un plaignant permettent de déclencher une enquête. Mais une allégation mensongère peut être pénalement sanctionnée, notamment au titre de la dénonciation calomnieuse, de la diffamation ou des fausses alertes.
L’allégation ne constitue pas nécessairement une preuve en tant que telle, mais sert à orienter le débat juridique et à fonder les prétentions d’une partie.
Objectifs et portée juridique de l’allégation
Fonder une demande en justice
Dans toute action en justice, le demandeur doit exposer les faits sur lesquels il fonde sa prétention. Ces faits, présentés sous forme d’allégations, constituent la base de l’instance. Sans eux, la demande est irrecevable car elle ne permet pas au juge d’exercer son office.
Conformément à l’article 6 du Code de procédure civile, le juge doit statuer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il ne peut donc pas inventer ou rechercher de lui-même des faits non allégués par les parties.
Exemples :
-
en droit du travail, un salarié peut alléguer avoir subi des faits répétés de harcèlement moral (pressions, humiliations, isolement) ;
-
en droit civil, un consommateur peut alléguer que le bien livré ne correspond pas aux caractéristiques promises ;
-
en droit commercial, un créancier peut alléguer que son débiteur n’a pas exécuté son obligation de paiement à l’échéance prévue.
Ces allégations orientent l’instruction et ouvrent la voie à la phase probatoire : il appartient ensuite à la partie qui les avance de produire des éléments de preuve (documents, témoignages, constats d’huissier, expertises).
Structurer les arguments d’une défense
Le défendeur n’est pas passif : il peut à son tour formuler des allégations pour contester les faits ou les circonstances avancés par la partie adverse, ou encore pour proposer une autre lecture de la situation.
Les allégations de défense peuvent prendre plusieurs formes :
-
la contestation des faits : nier leur existence ou leur exactitude (ex. l’employeur qui conteste la réalité des agissements de harcèlement invoqués par un salarié) ;
-
la contextualisation : reconnaître les faits mais en donner une interprétation différente (ex. un retard de livraison expliqué par un cas de force majeure) ;
-
l’invocation de faits justificatifs : avancer de nouveaux éléments de fait propres à exonérer ou limiter sa responsabilité (ex. paiement déjà effectué, compensation entre créances réciproques).
Ces allégations, comme celles du demandeur, doivent être étayées par des preuves. Le juge, tenu par le principe du contradictoire (art. 16 CPC), doit examiner les allégations et les preuves apportées par chaque partie, puis leur appliquer la qualification juridique adéquate.
Caractéristiques essentielles de l’allégation
Allégation et preuve
L’allégation constitue une affirmation de fait formulée par une partie, mais elle n’a aucune valeur probatoire par elle-même. En droit français, elle doit être corroborée par des éléments de preuve recevables, qu’il s’agisse de pièces écrites, de témoignages, de présomptions ou d’expertises judiciaires.
Deux principes cardinaux gouvernent cette articulation :
-
l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
-
l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Ainsi, l’allégation oriente le débat mais ne peut, à elle seule, emporter la conviction du juge.
Exemples :
-
En matière civile, un créancier qui allègue le non-paiement d’une facture doit en produire une copie et démontrer l’absence de règlement (extrait comptable, courrier de relance).
-
En droit du travail, un salarié qui allègue des heures supplémentaires doit fournir des éléments précis (plannings, courriels, attestations) permettant au juge de former sa conviction, l’employeur devant alors répondre par ses propres éléments (art. L.3171-4 C. trav.).
-
En droit pénal, une victime qui allègue des faits délictueux déclenche l’enquête, mais seule la réunion d’indices concordants et d’éléments de preuve permettra une condamnation (art. 427 CPP : preuve libre mais appréciée selon l’intime conviction du juge).
Une allégation non démontrée n’est pas « irrecevable » au sens procédural, mais elle reste dépourvue de force probante : le juge ne peut fonder sa décision sur une simple affirmation non étayée. Elle ne produit donc aucun effet juridique utile.
L’allégation en droit pénal
En matière pénale, l’allégation occupe une place particulière.
-
Lorsqu’une plainte ou une dénonciation est déposée auprès de la police, de la gendarmerie ou du procureur, la personne qui saisit l’autorité allègue l’existence de faits susceptibles de constituer une infraction.
-
Ces faits allégués servent de point de départ à l’action publique : ils permettent au parquet d’ouvrir une enquête préliminaire ou une information judiciaire.
-
L’allégation ne vaut pas preuve : elle doit être vérifiée par l’enquête (auditions, expertises, perquisitions, saisies, etc.) puis soumise à l’appréciation du juge pénal.
Distinction entre allégation et preuve
Contrairement au droit civil où l’allégation structure le débat contradictoire, en droit pénal elle sert de déclencheur procédural.
-
Le juge d’instruction ou la juridiction de jugement ne peut se fonder sur une simple allégation : une condamnation exige des preuves suffisantes et établies selon les règles de procédure (art. 427 CPP : la preuve est libre mais appréciée par le juge selon son intime conviction).
-
Ainsi, une allégation non corroborée ne peut jamais suffire à emporter une condamnation pénale.
Les allégations mensongères en matière pénale
Une allégation volontairement fausse peut être lourdement sanctionnée. Plusieurs infractions existent :
-
La dénonciation calomnieuse (art. 226-10 C. pén.) : incrimine le fait de dénoncer un fait imaginaire ou inexact à une autorité judiciaire ou administrative, dans l’intention de nuire à autrui.
-
La diffamation (art. 29 de la loi du 29 juillet 1881) : sanctionne les allégations portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.
-
La fausse alerte (art. 322-14 C. pén.) : vise le fait d’alerter mensongèrement les autorités d’un danger inexistant (ex. attentat, incendie, catastrophe).
-
Le faux témoignage (art. 434-13 C. pén.) : sanctionne l’allégation mensongère faite sous serment devant une juridiction.
Conséquences procédurales
Une allégation mensongère peut exposer son auteur à une poursuite pénale, à des dommages-intérêts civils en réparation du préjudice moral ou matériel causé, et à une perte de crédibilité devant le juge.
À l’inverse, une allégation de faits vraisemblables et sérieuse, même si elle n’est pas confirmée par la suite, ne constitue pas une infraction si elle a été faite de bonne foi.
Conclusion
L’allégation est un outil central du raisonnement juridique : elle structure le débat judiciaire, permet d’introduire une demande, d’organiser une défense ou de déclencher l’action publique. Elle n’a cependant de portée que si elle est corroborée par des preuves, car en droit français l’affirmation ne vaut pas démonstration.
Employée de bonne foi, l’allégation participe au respect du contradictoire et à la manifestation de la vérité. Utilisée de manière mensongère ou abusive, elle expose son auteur à des conséquences civiles (responsabilité, amende civile) et pénales (dénonciation calomnieuse, diffamation, faux témoignage).
Au-delà des procédures, la notion s’étend aussi à la vie économique : allégations publicitaires ou contractuelles engagent la responsabilité de celui qui les formule. La maîtrise de ce concept est donc essentielle tant pour les justiciables que pour les acteurs économiques, afin de sécuriser leurs propos et leurs actes dans le respect du droit.
Vous êtes dirigeant de TPE ou PME ? Profitez de notre abonnement juridique et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé tout au long de l’année.