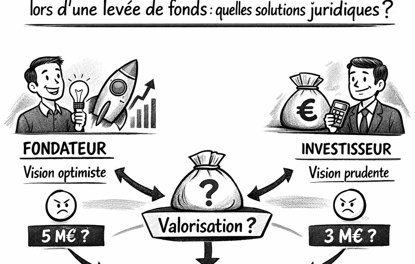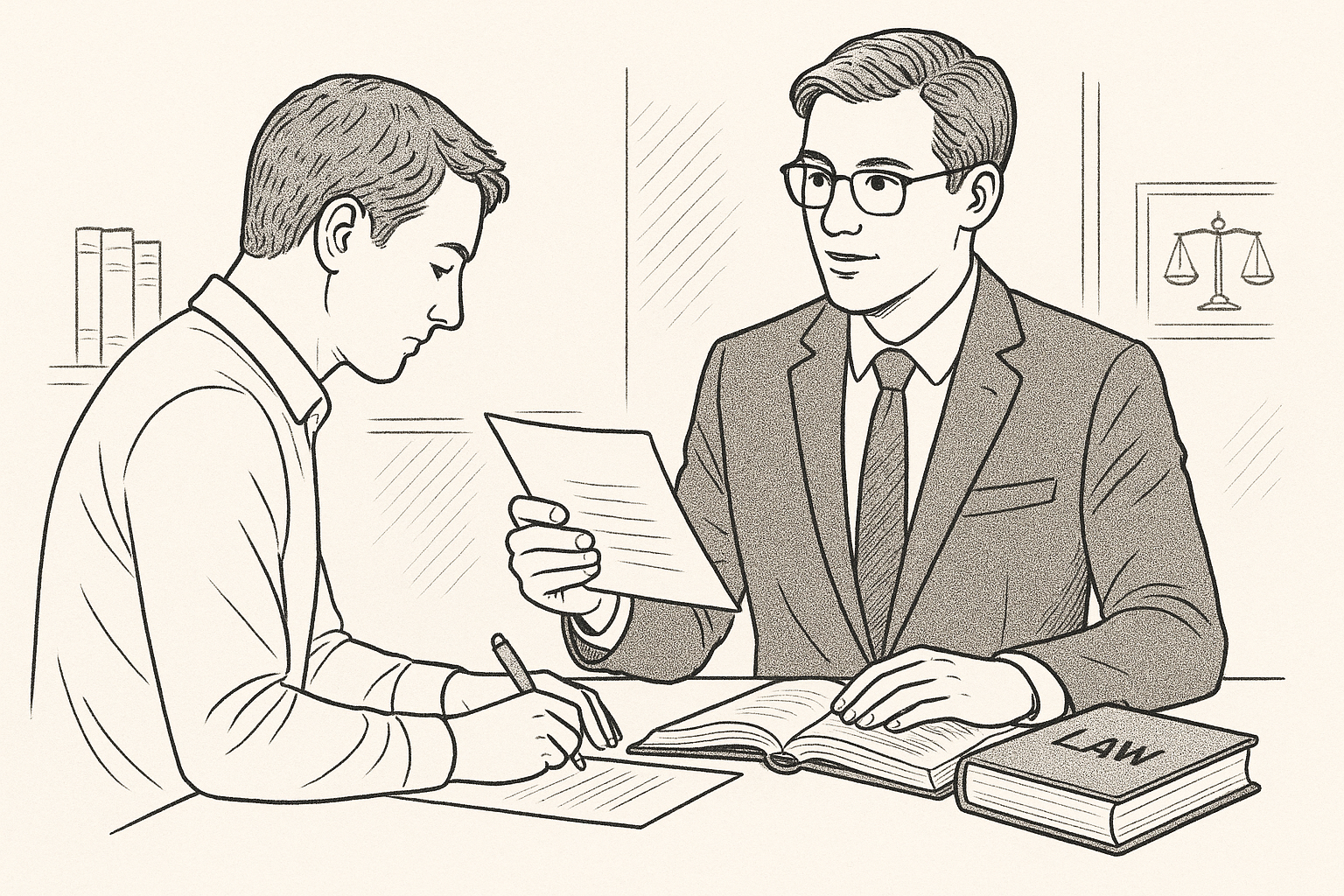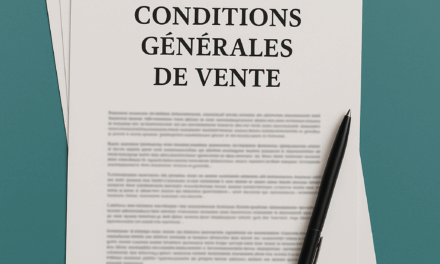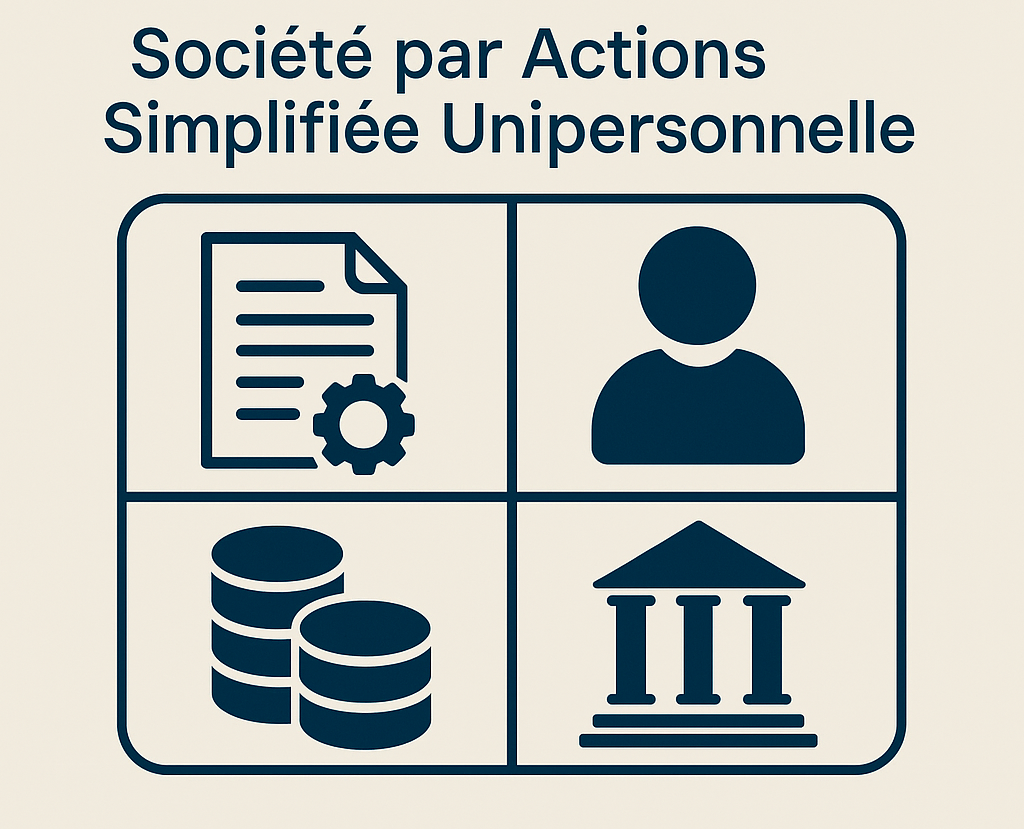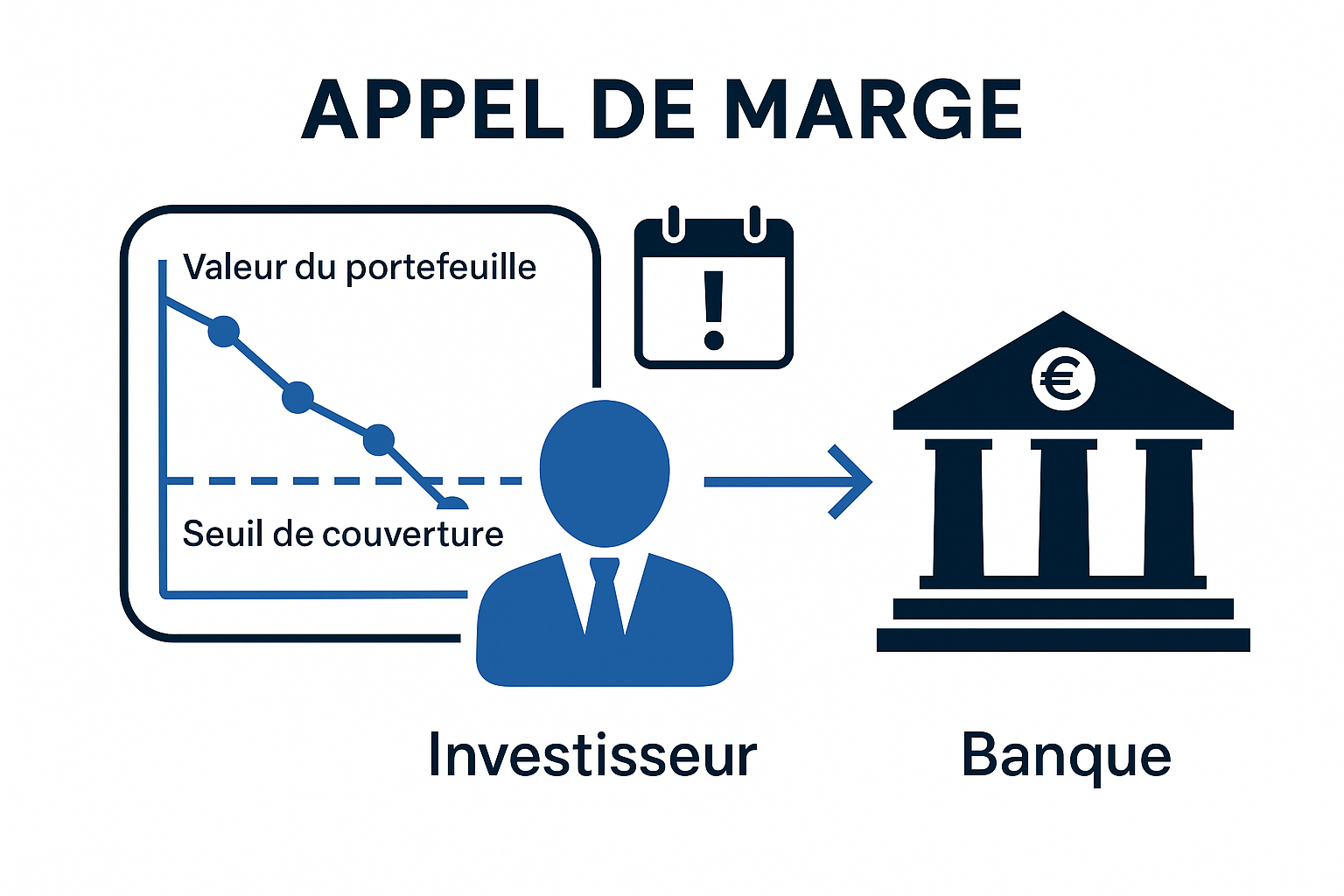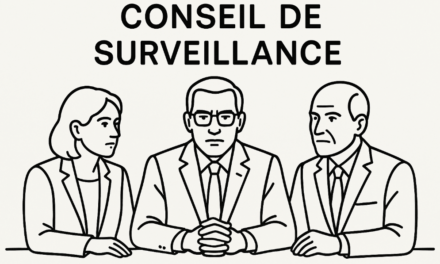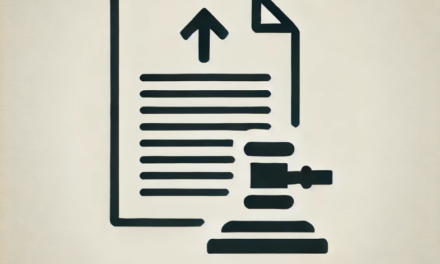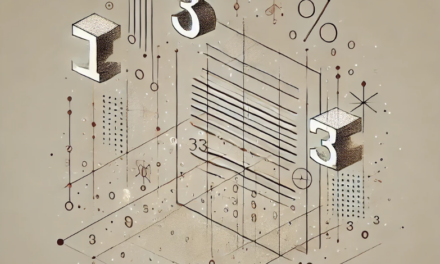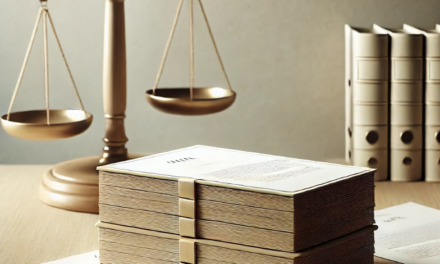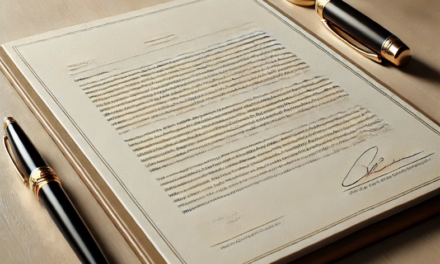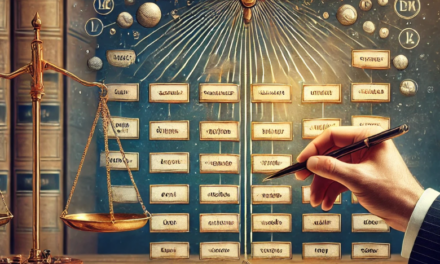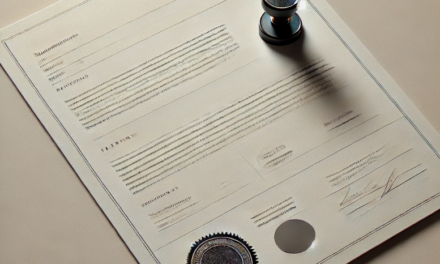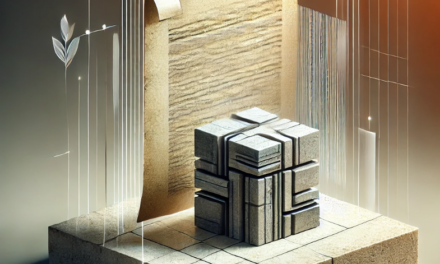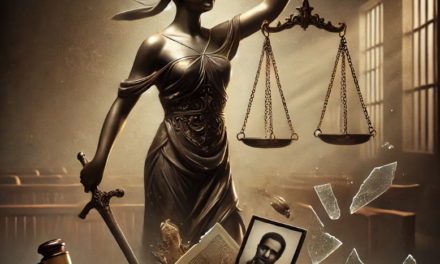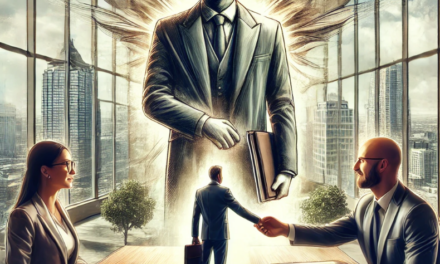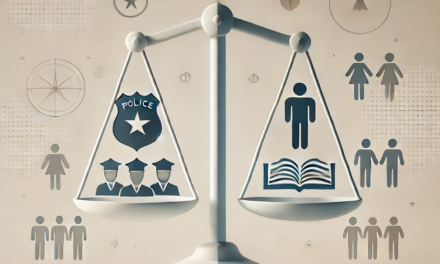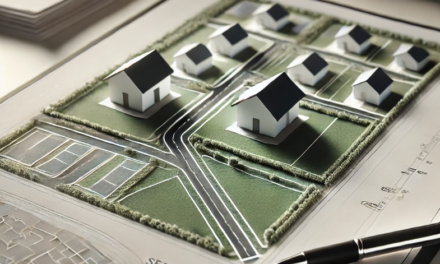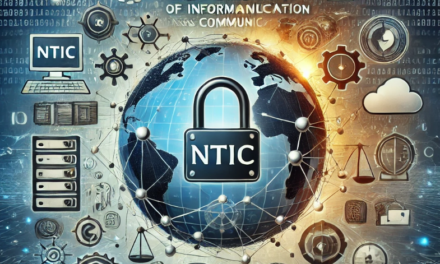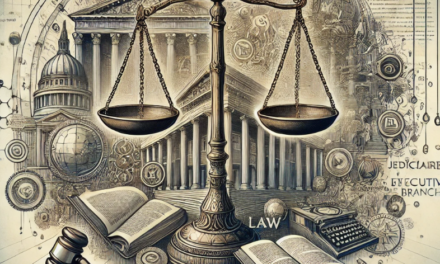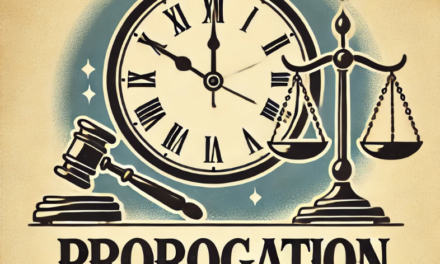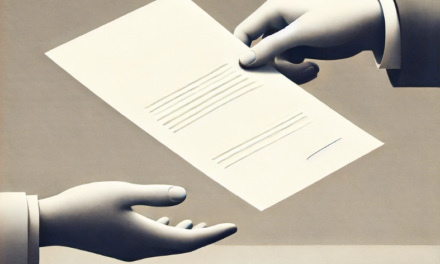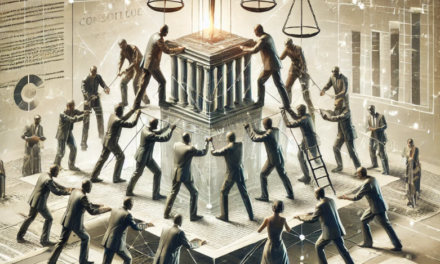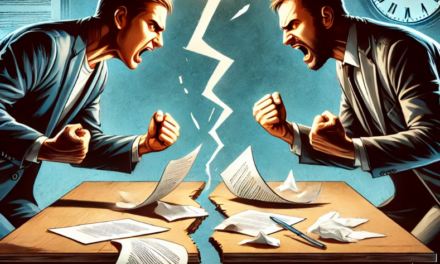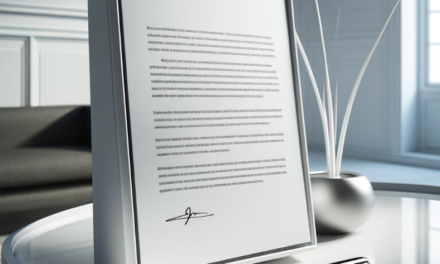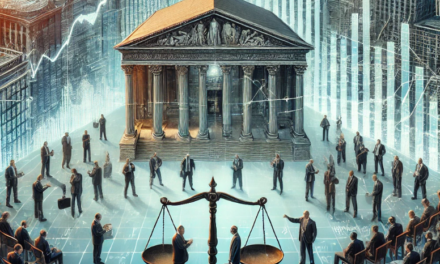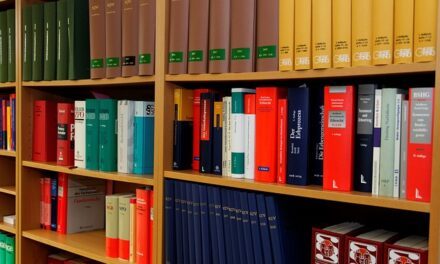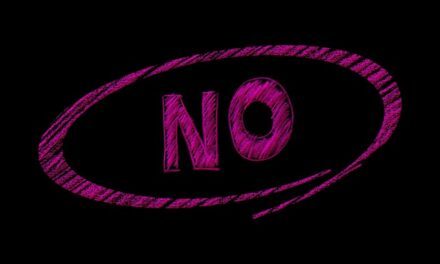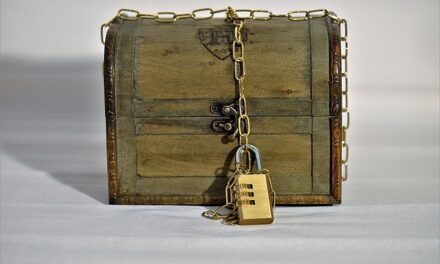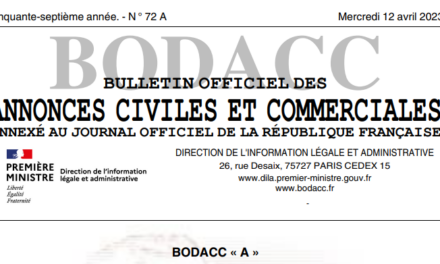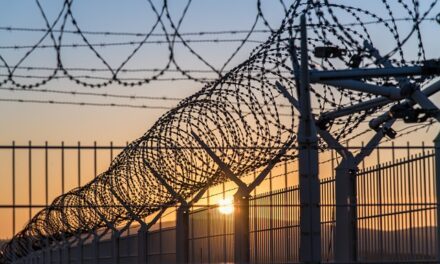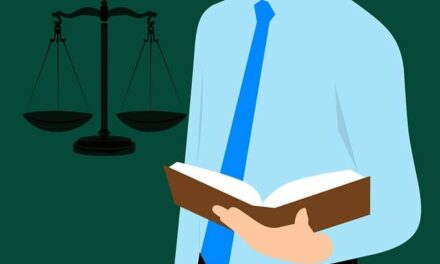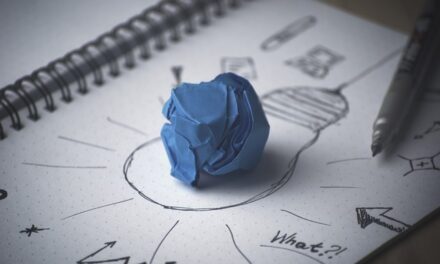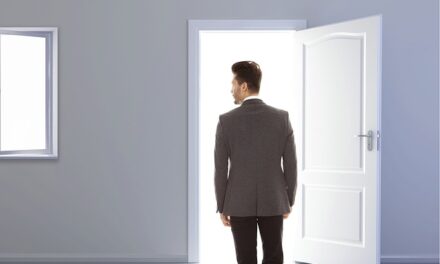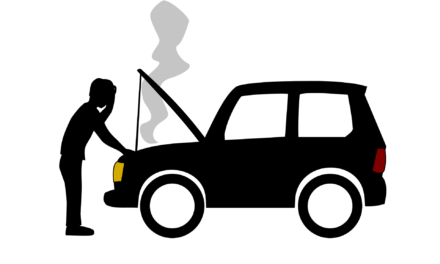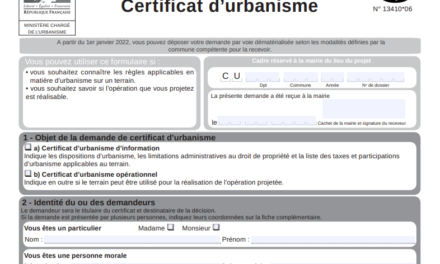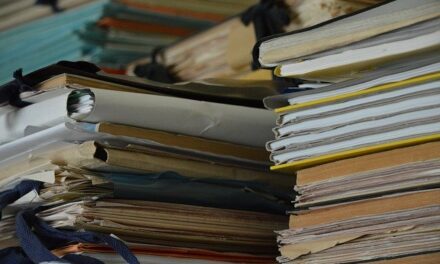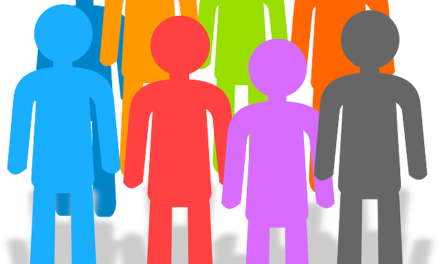Le recours est un mécanisme juridique fondamental permettant à une partie de contester une décision administrative ou juridictionnelle devant une autorité supérieure. Il constitue une garantie essentielle du droit à un procès équitable et à une bonne administration de la justice. En fonction de la nature de la décision contestée, il existe plusieurs types de recours, chacun répondant à des conditions et à des délais spécifiques.
Définition
Un recours est une voie de droit permettant à une personne (physique ou morale) d’obtenir la révision, l’annulation ou la modification d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire. Il repose sur le principe fondamental du droit au juge, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Fondements juridiques
Le droit au recours est encadré par plusieurs textes juridiques, notamment :
- Le Code de procédure civile, qui régit les recours contre les décisions judiciaires civiles et commerciales.
- Le Code de justice administrative, qui définit les modalités des recours contre les actes administratifs.
- Le Code pénal et le Code de procédure pénale, qui organisent les voies de recours en matière répressive.
- Les conventions internationales, qui consacrent un droit au recours effectif (ex. article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme).
Les différents types de recours
Les recours administratifs
Les recours administratifs visent à contester une décision d’une autorité administrative. Ils sont de deux sortes :
- Le recours gracieux : il est formé auprès de l’auteur de la décision contestée et vise à obtenir son retrait ou sa modification.
- Le recours hiérarchique : il est exercé auprès de l’autorité supérieure à celle qui a pris la décision.
Ces recours doivent être exercés dans un délai spécifique, généralement de deux mois à compter de la notification de la décision.
Les recours juridictionnels
Ils s’exercent devant une juridiction compétente pour contester une décision administrative ou judiciaire. On distingue plusieurs catégories :
- Le recours pour excès de pouvoir (REP) : utilisé en droit administratif, il permet de demander l’annulation d’un acte administratif illégal.
- Le recours de pleine juridiction : il permet au juge d’examiner non seulement la légalité, mais aussi l’opportunité de la décision attaquée (ex. recours en responsabilité de l’administration).
- Les voies de recours en matière judiciaire : elles permettent de contester une décision rendue par une juridiction civile, pénale ou commerciale.
- L’appel : permet de faire réexaminer une décision de première instance par une juridiction supérieure (voir l’article : Comment faire appel d’un jugement)
- L’opposition : permet à une partie défaillante d’obtenir un nouvel examen d’un jugement rendu par défaut.
- Le pourvoi en cassation : vise à contester une décision devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État en cas de violation du droit.
- La tierce opposition : permet à un tiers affecté par une décision judiciaire de la contester.
- La révision : procédure exceptionnelle permettant de remettre en cause une décision définitive en raison de la découverte d’un fait nouveau.
Conditions et délais des recours
Pour être recevable, un recours doit remplir certaines conditions :
- Qualité et intérêt à agir : le requérant doit justifier d’un intérêt personnel et direct à contester la décision.
- Respect des délais : chaque type de recours est soumis à un délai précis. Par exemple, l’appel en matière civile doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
- Motivation du recours : il doit être fondé sur des moyens de fait et de droit pertinents.
Délais applicables
- Recours administratif : généralement 2 mois après la notification de la décision.
- Appel : 1 mois en matière civile, 10 jours en matière pénale.
- Pourvoi en cassation : 2 mois après la notification de la décision attaquée.
- Recours pour excès de pouvoir : 2 mois à compter de la publication ou de la notification de l’acte administratif.
Effets des recours
Effet suspensif
Certains recours, comme l’opposition et l’appel en matière pénale, ont un effet suspensif, empêchant l’exécution de la décision contestée jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue. Cela n’est pas le cas au civil. En outre, le pourvoi en cassation n’a en principe pas d’effet suspensif.
Effet dévolutif
L’appel a un effet dévolutif, ce qui signifie que la juridiction d’appel réexamine l’affaire dans son ensemble.
Effet rétroactif
Si le recours aboutit à l’annulation d’une décision, celle-ci est censée n’avoir jamais existé, produisant un effet rétroactif.
Conclusion
Le recours est un instrument fondamental garantissant le respect des droits des justiciables et la bonne application du droit. Son exercice doit cependant être encadré par des conditions strictes et respecter des délais impératifs. Il est donc essentiel pour tout justiciable ou professionnel du droit de bien comprendre les mécanismes et les enjeux des différentes voies de recours pour optimiser leur efficacité.